Voici la version Web du rapport de recherche que j’ai produit dans le cadre de mon stage de maîtrise chez Orange Labs à Paris, à l’automne 2014. Me basant sur dix entretiens semi-dirigés avec des utilisateurs de Deezer et Spotify, j’y analyse la transformation de leurs pratiques de consommation musicales. Je me penche tout particulièrement sur les formules de recommandation de ces plateformes numériques, ainsi qu’aux réactions qu’elles génèrent chez les utilisateurs.
Vous pouvez télécharger la version PDF de ce rapport. N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et bonne lecture!
Table des matières
Introduction
Revue de la littérature
La discomorphose d’Hennion
La numérimorphose de Granjon et Combes
Les pratiques musicales au Québec : Laplante et Poirier
La diffusion en continu
Quelques statistiques d’utilisation
Deezer
Spotify et Shazam
La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique
Les formules de recommandation de Deezer et Spotify
Méthodologie
Portraits des participants
Résultats
Contextes d’écoute
Transformation de la consommation
Transformation de l’écoute
Réseaux sociaux, vie privée et mise en scène de soi
La découverte musicale
Deezer : utilisation et compréhension
Discussion
Les caractéristiques de la nubémorphose
Conclusion
L’avenir de la diffusion musicale en continu
La sociologie culturelle en mouvement
Annexe 1 : Grille d’entretien
Annexe 2 : Lettre d’information et formulaire de consentement

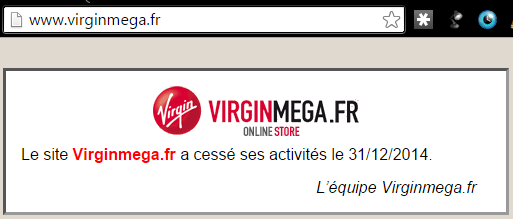
Figure 1 — Les 26 Virgin Megastore de France ferment leurs portes définitivement en juin 2013, proposant le service de téléchargement VirginMega comme solution de rechange. Le 31 décembre 2014, c’est au tour du service VirginMega de fermer de manière définitive.
Introduction ⇑
Le disque compact est mort. Ses lieux de vente ferment les uns après les autres. En France, on a vu en juin 2013 les 26 enseignes Virgin Megastore, lieu emblématique de la vente du disque au pays, fermer leurs portes d’un coup. Au Québec, on a vu en mai dernier Québecor Média se départir d’Archambault[1], sa chaîne de magasins grande surface spécialisée dans la vente de disques. Les lecteurs CD disparaissent de nos ordinateurs. La gamme entière des produits Apple en est dépourvue depuis 2013[2] — tout un revirement de situation pour une entreprise dont le slogan était « Rip. Mix. Burn » en 2001. La vente de fichiers musicaux, qui devait prendre le relais de celle du disque compact, est déjà en baisse au Canada depuis 2014[3]. Elle fait place à la diffusion en continu (le streaming), pratique en progression rapide au Canada comme aux États-Unis[4]. Dans les mots de Dominique Jutras de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, nous assistons depuis quelques années déjà à la « transformation des biens culturels en services culturels »[5]. Avec Spotify, Deezer, Google Play, Microsoft Groove et Apple Music — sans oublier YouTube, de loin le service de diffusion en continu le plus populaire[6] — cette nouvelle manière de consommer la culture est maintenant partout. Et alors que nous avons atteint un point tournant dans nos habitudes culturelles, c’est tout un pan de la recherche sociologique qui doit être revisité.
Dans l’ouvrage Figures de l’amateur publié en l’an 2000, Hennion, Maisonneuve et Gomart présentent le concept de la « discomorphose » :
L’accès désormais privilégié par le disque et ses dispositifs redéfinit la relation de l’amateur à la musique classique en général : le format du disque compact et de la chaîne haute-fidélité est aussi un formatage de l’écoute — durée, lieux, situations, modes opératoires, sélection, etc. — qui se transpose à l’ensemble de l’appréhension de la musique[7].
Six ans plus tard, Granjon et Combes, inspirés par ce concept, proposent celui de la « numérimorphose » pour rendre compte de la « réorganisation des pratiques des amateurs » liée à « la numérisation du signe sonore, à la dématérialisation des supports et à la multiplication des équipements »[8]. Pour rendre compte à mon tour de cette nouvelle réalité de la diffusion en continu, je propose ici le concept de « nubémorphose »[9], issu de l’analyse de dix entretiens semi-dirigés avec des utilisateurs de Deezer, Spotify et YouTube résidant en région parisienne. La présente étude dresse le portrait de la consommation musicale de ces dix répondants, en se penchant tout particulièrement sur les usages des nouveaux dispositifs de recherche et de recommandation propres aux services de diffusion en continu. Comment leurs pratiques musicales se sont-elles transformées depuis l’ère du CD ? Comment choisissent-ils ce qu’ils écoutent sur Deezer, Spotify ou YouTube ? De quelles manières perçoivent-ils les recommandations musicales affichées sur ces plateformes de diffusion ?
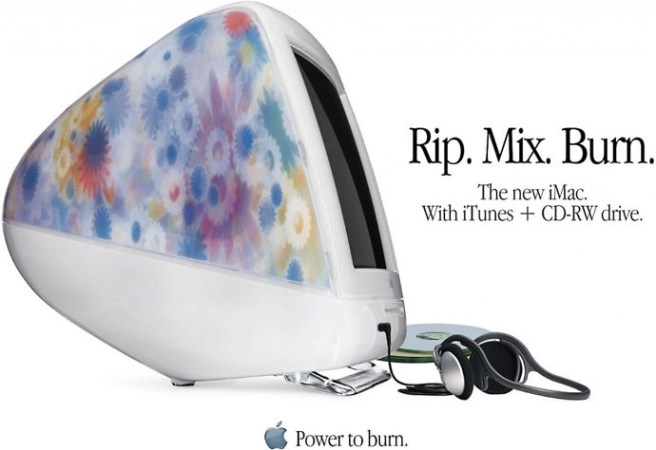
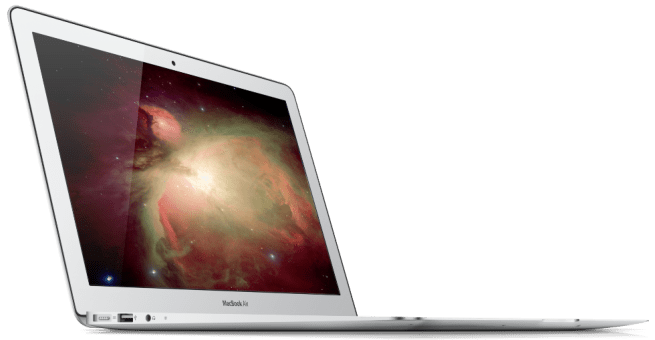
Figure 2 — Un mois après avoir lancé son logiciel iTunes, Apple introduit en février 2001 ses nouveaux ordinateurs iMac équipés de graveurs CD. « Le iMac a évolué en un centre de divertissement où on peut créer des films, organiser sa collection de musique et graver ses propres CD musicaux. […] iTunes permet à ses utilisateurs d’importer des chansons de leurs albums favoris dans leur iMac en les compressant au format MP3 ; de les organiser avec des fonctions de recherche, de navigation et de listes de lecture très avancées […] »[10]. En dessous, le MacBook Air, introduit en janvier 2008 ; le premier modèle d’ordinateur Apple sans lecteur CD depuis le PowerBook 2400 en 1997[11].
Revue de la littérature ⇑
La discomorphose d’Hennion
La musique est parmi les activités culturelles les plus prisées par les Français. Selon les données du projet de recherche Entrelacs de 2007, la consommation musicale est une pratique qui touche 92 % des Français ; 39 % d’entre eux écoutent de la musique quotidiennement, alors que 36 % le font au moins une fois par semaine[12]. Résultat d’un « élargissement de l’offre culturelle, des avancées du progrès technique, mais aussi du renouvellement des mécanismes de consécration et de légitimation de la culture »[13], l’intérêt porté à la musique s’est accentué depuis les années 1960, au point où la consommation musicale représente aujourd’hui une des pratiques culturelles les plus courantes, faisant partie du quotidien d’une très large portion de la population. La musique occupe une place particulièrement importante dans la vie des jeunes Français : 68 % d’entre eux en écoutent quotidiennement[14]. Au Québec, l’étude La Participation culturelle des jeunes à Montréal, menée en 2012, arrive au même constat : la musique est « au cœur même de l’univers culturel des jeunes ». Il s’agit de la pratique culturelle « la plus répandue, de même que l’activité la plus importante pour eux »[15].
Antoine Hennion, par ses nombreuses recherches en sociologie de la musique, des médias et des industries culturelles depuis les années 1980, est parmi les chercheurs les mieux placés pour étudier cette évolution rapide des pratiques musicales des dernières décennies. S’intéressant aux usages de la musique « à partir de l’auditeur et de ses entours et non de la musique elle-même », il étudie dans Figures de l’amateur le cas de la musique classique, en particulier « la relation complexe de production réciproque qui la lie au disque »[16]. Son enquête comporte 25 entretiens approfondis avec 13 amateurs abordés à la sortie de magasins de disque et lors de différents concerts le jour de la Fête de la musique, 9 disquaires, 2 responsables de service artistique dans des maisons d’édition et un journaliste spécialisé[17]. À ces entretiens semi-directifs viennent s’ajouter plusieurs séances d’observation dans des magasins de disque. L’objectif est d’étudier la musique classique dans son occupation visuelle et sonore de l’espace quotidien, sa présentation et représentation « du magasin aux lieux d’écoute » ; et par « l’ensemble complexe […] que constituent les professionnels du disque, les différents médias, les disquaires, le marché et le public »[18].
Hennion s’intéresse à la configuration de l’espace dédié au classique à l’intérieur du magasin Virgin. Promotions, sélections et compilations à l’entrée ; opéra dans l’alcôve à gauche ; musique contemporaine et importations au fond[19].
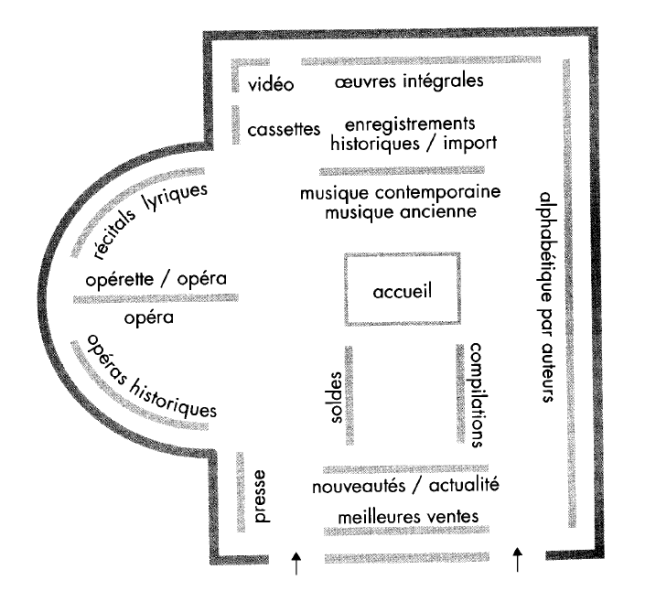
Figure 3 — Plan du rayon classique chez Virgin (tiré de Hennion et coll. 2000, p. 87)
Dans le magasin, le disque s’appréhende non pas par le son, mais par une multitude de repères visuels : « l’addition de noms » — genres, compositeurs, interprètes… – et de descriptifs, systèmes d’étoiles, pochettes attirant le regard témoignent du travail de toute une série d’intermédiaires, qu’ils soient éditeurs, critiques ou disquaires[20].
Les médias représentent un autre « lieu d’ancrage » important de la présence musicale[21]. La radio est présentée comme un moyen de découverte privilégié, une manière pour la musique de « prendre » l’auditeur, de venir à lui sans qu’il fasse de démarche particulière. La télévision « offre des accès divers à la musique classique » : par la musique des publicités, les reportages et les retransmissions de concert qui « présentent la musique comme un faire », la rendant « plus audible » grâce à l’ajout du visuel. Le cinéma quant à lui est un important « déclencheur » ; les cinéphiles veulent réécouter la musique entendue sur le grand écran. Un élément particulièrement important de cette présence médiatique pour les amateurs est l’inscription de la musique dans l’actualité : on veut suivre ce qui est « à l’ordre du jour ».
Hennion constate chez les amateurs « l’énorme importance du recours au réseau des proches »[22], que ce soit pour des conseils, l’échange de disques ou encore des recommandations d’achats ou de concerts. Cette relation se base sur une confiance « doublement fondée », à la fois sur la relation personnelle partagée avec cette personne et sur sa compétence.
Enfin, le disque « redéfinit la relation de l’amateur à la musique classique en général »[23] de plusieurs manières. Contrairement au concert, il est « le médium d’une relation intime à la musique » ; écouté chez soi, selon l’humeur et le moment. Il fait émerger la « discothèque », la collection, comme nouveau mode d’accumulation de la musique. Le format même du CD — ses plages courtes facilement repérables, sa durée d’environ une heure, la cohérence de l’assemblage des titres et des interprètes — définit un nouveau format d’écoute[24]. Le disque « fait glisser l’appréhension de la musique classique comme un ensemble d’œuvres à un ensemble d’enregistrements », et fait passer au second plan la prestation publique en temps réel[25].
La numérimorphose de Granjon et Combes
S’inspirant des travaux de Hennion, Maisonneuve et Gomart, Granjon et Combes présentent dans l’article La Numérimorphose des pratiques de consommation musicale leur propre hypothèse sur l’évolution des pratiques musicales.
Si l’amateur de musique est « l’enfant du mariage de la musique et du marché, dont l’union n’a pu être consommée que lorsque la technique a su faire de la musique un bien et un service », il est aussi, dorénavant, le fils des amours ancillaires de la massification de la culture et de la numérisation du signe qui ont fait des contenus musicaux des biens éminemment reproductibles, accessibles, archivables, transmissibles et non rivaux[26].
Fondée sur les données statistiques du projet Entrelacement des pratiques de communication et de loisir[27] d’Orange Labs, ainsi que d’une trentaine d’entretiens semi-directifs conduits auprès de jeunes amateurs de musique âgés de 17 à 35 ans dont la consommation musicale est « quotidienne et importante », l’analyse de Granjon et Combes rend compte du passage du disque au MP3 et de la « multiplication des modalités de consommation liées à la multiplicité des prothèses technologiques utilisées »[28].
La numérimorphose marque une évolution importante par rapport à la discomorphose d’Hennion, et ce, à plusieurs égards. D’abord, le son studio imposé par le disque, maintenant numérisé, se prête à un ensemble d’opérations nouvelles sur ordinateur de par sa plasticité inédite. L’assemblage, le mix, le remix et les collages en tous genres font émerger une nouvelle esthétique sonore, de nouveaux styles musicaux hybrides. Ensuite, là où la discomorphose mettait de l’avant l’album, la numérimorphose met en valeur « l’entité morceau », voire parfois le fragment de morceau musical, et sur des plateformes Web – Webradios, streaming – qui s’éloignent du support CD « que l’on achète et grave de moins en moins »[29]. Enfin, les coûts de production et de distribution fortement réduits par le passage au numérique bouleversent l’industrie de la musique, dont le modèle d’affaires continue à être fondé sur un marché de biens matériels promus par les médias de masse. Les nouvelles solutions de monétisation des contenus, notent les auteurs, « restent encore largement à l’état d’expérimentation » et tardent à émerger[30]. Les cadres de la discomorphose « restent encore largement à l’œuvre », mais se voient transformés peu à peu par le format numérique et la multiplication des équipements.
Premier élément d’analyse des auteurs : la socialisation culturelle et la consommation médiatique apparaissent comme les deux principaux phénomènes liés à la découverte musicale dans le cadre de la numérimorphose. Les réseaux relationnels demeurent les principaux relais des pratiques culturelles. « Que les amateurs soient dans un rapport plutôt profane ou plutôt expert à la musique, les frottements culturels qui prennent corps au sein de leurs réseaux de sociabilité sont des ressources essentielles de la constitution de leurs goûts et de leurs consommations »[31]. Granjon et Combes observent notamment chez leurs répondants que le fait de disposer d’un lecteur MP3 ou encore d’une clé USB sur soi permet de « récupérer des contenus musicaux au gré des rencontres », d’échanger en tout temps découvertes et coups de cœur avec son entourage immédiat. On note aussi que ce « foisonnement relationnel » tend à s’estomper avec l’âge[32].
Les médias d’information jouent eux aussi un rôle central dans la découverte musicale et le développement des goûts musicaux. Fortement consommées par les amateurs ayant participé à l’étude, la télévision et la radio continuent de « prendre » les auditeurs comme l’avait décrit Hennion, de les exposer à de nouveaux contenus. Qui plus est, soulignent Granjon et Combes, la spécialisation des goûts des amateurs s’accompagne d’une spécialisation de leur consommation musicale. Les amateurs « profanes » cherchent dans les médias la nouveauté, le dernier single à la mode, alors que les amateurs « experts » cherchent à trouver une pièce rare ou encore à compléter leur discographie[33].
La numérimorphose facilite grandement le partage et l’échange des contenus musicaux. Selon les données des auteurs, 82 % des moins de 25 ans échangent régulièrement de la musique, et cette pratique tend à diminuer avec l’âge[34]. Ces échanges sont « de moins en moins synonymes de rencontre physique ou de lien d’attachement » alors qu’Internet et les plateformes P2P permettent des relations qui « échappent aux contraintes spatiales »[35]. L’acquisition de contenus musicaux, transformée par le numérique, diffère aussi selon le rapport des amateurs à la musique. Les « experts », en tant que « méticuleux possesseurs et collectionneurs », accordent encore une place « prégnante » au CD et se méfient des plateformes d’acquisition de contenu musical numérique payant ; ils sont réticents à acquérir un contenu strictement sonore, dépourvu de toute matérialité qui leur permettrait « d’ancrer » leur consommation. Les « profanes », de leur côté, considèrent maintenant l’achat de disques comme « superflu ». Leur consommation « éphémère de hits », suivant la « culture du tube » du marché les amène à adhérer aux usages liés aux technologies numériques sans retenue, et avec le morceau individuel plutôt que l’album comme unité d’acquisition et de partage[36].
Les jeunes, observent Granjon et Combes, ne disposent plus généralement que d’une CDthèque « restreinte, le plus souvent composée de disques offerts par des proches »[37]. C’est l’ordinateur qui est devenu l’outil de gestion musical principal ; c’est là qu’on vient graver ses CD favoris en fichiers musicaux, qu’on organise une sonothèque « la plupart du temps surdimensionnée » de plusieurs dizaines, voire centaines, de giga-octets et qui alimente iPod et autres lecteurs MP3. Ces sonothèques sont « soigneusement classées » chez les amateurs « experts », qui sont « attentifs à la présence des titres, des morceaux et des illustrations de l’album »[38]. Faisant l’acquisition de contenu musical par morceaux plutôt que par albums, et se souciant généralement moins de l’organisation de leur sonothèque, les amateurs « profanes » « déconstruisent systématiquement » les albums dans des compilations personnalisées, au gré des envies. Plutôt que d’indexer leurs morceaux par album, par date ou par label, les « profanes » les compilent dans des dossiers selon les genres, les ambiances musicales ou encore la fonction attendue de cette musique (« compile zen », « danse »…).
L’écoute de musique aussi est déconstruite : elle est « sans doute l’activité qui, sous l’effet de la dématérialisation des contenus et de leur nouvelle plasticité, s’avère être la plus déconstruite de toutes les opérations liées à la consommation de musique »[39]. En effet, la multiplication des équipements donne lieu à celle des lieux d’écoute. On écoute la musique à la maison, en voiture, au travail, presque partout. Plus importante encore est la déconstruction de l’écoute liée au format numérique en tant que tel, alors que le zapping et l’écoute en mode aléatoire renversent le rapport de déférence de l’amateur vis-à-vis de l’œuvre. Ces nouvelles pratiques peuvent « aller jusqu’à prendre la forme extrême d’écoutes erratiques où les morceaux ne sont jamais consommés dans leur entièreté », au gré de « lubies plus ou moins éphémères »[40]. L’écoute « instruite » des amateurs « experts » est opposée à l’écoute « légère » des « profanes », « avant tout appréhendée comme un divertissement, un passe-temps »[41].
Les pratiques musicales au Québec : Laplante et Poirier
Au Québec, ce sont les travaux d’Audrey Laplante qui se sont intéressés de plus près aux pratiques musicales à l’ère numérique. Dans sa thèse Everyday Life Music Information-Seeking Behavior of Young Adults publiée en 2008, elle analyse les pratiques de quinze Montréalais francophones, âgés de 18 à 29 ans, à partir d’entretiens semi-dirigés. Sa question est la suivante : comment les jeunes adultes découvrent-ils de nouvelles pièces musicales, de nouveaux artistes ou des genres musicaux nouveaux dans le contexte de la vie quotidienne ?
Les amis, les collègues et la famille, explique-t-elle, sont « de loin la source de découvertes musicales la plus importante » pour ses participants[42]. Les recommandations par les proches sont particulièrement prisées pour deux raisons. D’abord, comme ces personnes connaissent leurs goûts, elles sont en mesure d’offrir des recommandations personnalisées et le plus souvent pertinentes. Ensuite, comme les participants connaissent eux aussi les goûts de ces proches, ils peuvent facilement juger de la valeur et de la fiabilité de ces recommandations. Ces conseils s’accompagnent d’échanges de disques ou de fichiers musicaux.
Les sources d’information informelles — bibliothécaires, critiques, disquaires — sont quant à elles moins valorisées par les participants. Par exemple, sur le site de critiques Allmusic.com, que quatre d’entre eux consultent régulièrement, ils se contentent de trouver le ou les disques avec le plus d’étoiles pour un artiste donné, sans nécessairement lire les critiques expliquant ce classement. La liste des « artistes similaires » sur la page de chaque artiste est très appréciée, mais on déplore le fait que certains de ces liens paraissent inappropriés, et que ces incohérences sont certainement attribuables au fait que « l’objectif du site est de faire de l’argent »[43].
Fait intéressant, bien que tous les participants à l’étude aient été recrutés dans le hall d’entrée de la Grande Bibliothèque de Montréal, qui rend disponible une large collection de CD musicaux, seulement six d’entre eux (sur quinze) ont rapporté emprunter des enregistrements musicaux dans les bibliothèques[44]. Comme l’ont expliqué deux participants, pourquoi se déplacer pour ce qu’on peut télécharger gratuitement chez soi ? Le téléchargement illégal de fichiers musicaux est en effet courant chez les participants à l’étude : dix sur quinze le font « régulièrement ».
Laplante observe chez ses répondants que la recherche de nouvelle musique se fait souvent sans objectif spécifique, que ce soit sur le Web ou chez le disquaire. Les découvertes sont le résultat de « rencontres fortuites » (serendipitous encounters), par exemple l’écoute d’un artiste qu’on connaît déjà dans un café, ou encore en voiture, à la radio[45]. La recherche active se fait par furetage (browsing) ; les participants apprécient particulièrement fouiller dans les étalages de nouveautés chez le disquaire ou en ligne, tomber sur le portrait d’un artiste dans leur magazine favori, ou encore parcourir la collection musicale d’un ami sur son lecteur MP3[46]. Laplante conclut que pour satisfaire les besoins de jeunes auditeurs comme ceux de son étude, les plateformes musicales devraient 1) faciliter le furetage au lieu de présumer qu’une recherche avec objectifs précis sera faite 2) fournir des métadonnées riches et complètes qui décrivent la musique elle-même mais qui présentent également les liens entre les artistes ainsi que des évaluations critiques 3) faciliter les échanges entre utilisateurs 4) fournir des recommandations qui tiennent compte du contexte d’utilisation, ou de l’effet recherché 5) assurer une expérience de recherche qui soit agréable avant tout, comme l’objectif des utilisateurs est d’abord le plaisir, plutôt que la satisfaction d’un besoin informationnel précis[47]. Laplante continue dans ses recherches subséquentes à s’intéresser à la découverte musicale chez les jeunes, notamment par l’analyse de leurs réseaux relationnels[48].
L’étude La Participation culturelle des jeunes à Montréal de Christian Poirier et son équipe, menée quelques années après la thèse de Laplante, permet de suivre les pratiques culturelles des jeunes québécois alors qu’émergent les deux géants Facebook et YouTube. Alors qu’en 2007, MySpace était décrit par les jeunes comme étant la plateforme musicale par excellence, c’est YouTube — en ligne depuis février 2005 — qui devient la plateforme musicale privilégiée des jeunes en 2012. Deuxième plateforme Web la plus mentionnée chez les jeunes ayant participé à l’étude de Poirier, YouTube sert à écouter de la musique, à télécharger des pièces musicales[49] qui viendront alimenter le iPod ou le téléphone portable, à regarder des vidéoclips et des spectacles et, dans quelques cas, à mettre ses propres vidéos en ligne[50].
Je cherche beaucoup sur YouTube puis… Tu sais, c’est rare que les gens me disent « ah, écoute ça ». C’est vraiment moi qui vais faire des recherches sur des nouvelles tounes. D’habitude, c’est sûr que sur iTunes il y a des top dix, puis tout ça, je les écoute, c’est souvent moyen. Ce que j’aime, je vais chercher une chanson plus… un style plus effacé, puis il y a comme des suggestions à côté puis c’est là que je commence à…[51]
La diffusion en continu ⇑
Quelques statistiques d’utilisation
L’enquête Les Pratiques culturelles des Français, menée environ tous les dix ans depuis 1973 par le ministère de la Culture et de la Communication français, trace le portrait des pratiques culturelles « des personnes de 15 ans et plus résidant sur le territoire métropolitain et disposant d’une maîtrise de la langue française suffisante pour répondre à une enquête »[52]. Sa plus récente édition, réalisée en 2008 par Olivier Donnat, témoigne de l’arrivée massive des ordinateurs et de la multiplication des équipements électroniques dans les ménages français. De 1997 à 2008, le nombre de Français de plus de 15 ans disposant d’un ordinateur à la maison triple, passant de 22 à 65 %, pendant que celui des Français ayant accès à Internet à domicile passe d’à peine 1 % à 56 %[53]. S’il est vrai que les pratiques culturelles convergent vers les écrans, Donnat précise que l’enquête 2008 représente « une situation d’entre-deux », un « moment où les usages du numérique peinent encore à se stabiliser »[54]. La révolution numérique transforme la manière dont on accède aux contenus culturels, mais « n’a pas bouleversé la structure générale des pratiques culturelles ni surtout infléchi les tendances d’évolution de la fin du siècle dernier »[55]. En effet, sauf pour la télévision et la radio dont l’écoute est en baisse, les changements « restent d’ampleur limitée et surtout s’inscrivent dans le prolongement des tendances » déjà observées[56]. Cela dit, explique Donnat, on peut entrevoir d’importants changements à venir lorsqu’on quitte le niveau général pour s’intéresser aux jeunes, principaux responsables des baisses d’écoute pour la radio et la télévision par exemple, et dont les goûts se tournent vers la culture anglo-saxonne.
Selon l’enquête de 2008, 52 % des Français ont déclaré avoir acheté des disques au cours des douze derniers mois, et 19 % ont déclaré avoir téléchargé de la musique[57]. Les jeunes sont les plus nombreux à écouter de la musique quotidiennement : 74 % des 15-19 ans le font contre 40 % des 35-44 ans et 15 % des 55-64 ans[58]. Sans surprise, les jeunes téléchargent beaucoup plus la musique que leurs aînés : « six lycéens sur dix l’ont déjà fait, soit trois fois plus que les 35-44 ans »[59]. Les données de l’enquête Entrelacement des pratiques de communication et de loisir citées par Granjon et Combes ajoutent à ce portrait que si 47 % des individus équipés d’un ordinateur l’utilisent pour écouter de la musique, c’est 83 % des 12-15 ans qui le font[60]. Il est à noter que ces deux enquêtes, publiées en 2007 et 2008, ne rendent pas compte de l’émergence des services de diffusion en continu comme Deezer et Spotify, qui n’existaient pas encore à l’époque. YouTube lui-même, lancé en novembre 2005, en était encore à ses débuts. Nous devrons ainsi attendre la nouvelle enquête Pratiques Culturelles des Français pour obtenir un portrait statistique national de ces récents développements.
On dispose de statistiques plus récentes au Québec avec les enquêtes NETendances 2012 et 2014 du Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO)[61]. Fondées sur des sondages téléphoniques auprès de 1000 Québécois de 18 ans et plus[62], ces enquêtes mesurent en effet depuis 2012 l’écoute de musique en continu, en plus des autres facettes du divertissement en ligne comme la Webtélé (Netflix), les jeux en ligne et le livre numérique. On y observe que c’est déjà le quart de la population adulte québécoise (24 %) qui écoute de la musique en continu (avec des services comme Grooveshark et Rhapsody) en 2012, ce qui représente 28 % des internautes d’âge adulte au Québec. Le téléchargement de musique (gratuite ou payante) ainsi que la Webradio sont quant à eux en progression, passant respectivement de 21 à 28 % et de 23 à 33 % de la population adulte québécoise entre 2010 et 2012. Comme Donnat dans son enquête Les Pratiques Culturelles des Français 2008, le CEFRIO insiste sur la nature générationnelle des pratiques de consommation musicale des Québécois. Une « fracture » située à 45 ans sépare la population : les internautes de 18 à 44 ans sont plus du double des 45 ans et plus à télécharger de la musique (payante ou non), avec des proportions respectives de 48 et 18 %. L’écart est moins large en ce qui a trait à l’écoute de musique en continu, avec 36 % des internautes de 18 à 44 ans contre 20 % de ceux de plus de 45 ans.
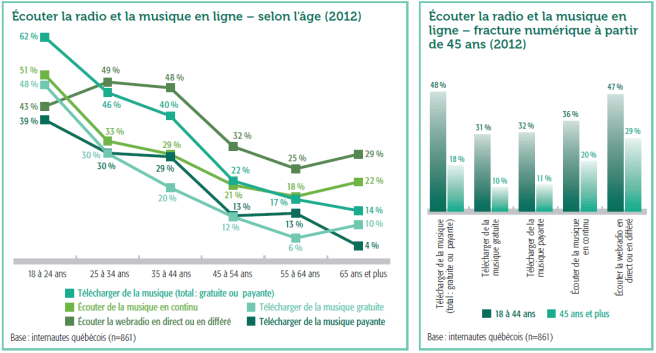
Figure 4 – Enquête NETendances 2012, CEFRIO, p. 11.
Du côté des États-Unis, le 2014 Nielsen U.S. Music year-end report indique une forte hausse dans l’écoute de musique en continu. C’est près de 164 milliards de pièces musicales individuelles qui sont diffusées (diffusion vidéo ou audio) en 2014, une progression de 55 % par rapport à l’année précédente. Un peu moins de 141 millions de CD et de 106 millions d’albums au format numérique sont achetés aux États-Unis en 2014, une consommation en baisse respectivement de 15 et 9 %. Pendant ce temps, les ventes de disques vinyles atteignent le chiffre record de 9 millions, en progression de 52 % par rapport à l’année précédente. Le rapport note que l’écoute de musique sur téléphone intelligent (smartphone) dépasse maintenant celle sur iPod, alors que 41 % des auditeurs écoutent de la musique sur leur téléphone. La radio, sur bande FM et sur Internet, demeure la première source de découverte musicale au pays, avec 51 % des consommateurs qui utilisent la radio pour découvrir de la nouvelle musique[63].
Deezer
Lancé en 2007 à Paris, le service de diffusion musicale en continu Deezer permet d’écouter un catalogue de 35 millions de titres sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Aujourd’hui présent dans 186 pays, le service compte 16 millions d’utilisateurs actifs, dont 5 millions d’abonnés payants[64]. Dans son offre gratuite, Deezer permet l’écoute sur demande de toutes les pièces de son catalogue, entrecoupée de publicités occasionnelles. On peut sauter (skip) jusqu’à six chansons à l’heure, la navigation à l’intérieur des titres (audio scrubbing) n’est pas permise, et la qualité audio est limitée à 128 kbit/s au format MP3. Pour 9,99 € ou 9,99 $ CA par mois, l’offre Deezer Premium permet l’écoute illimitée sur ordinateur, tablette et téléphone mobile, sans interruptions publicitaires et à une qualité audio allant jusqu’à 320 kbit/s au format MP3. L’offre Premium permet aussi de télécharger les titres sur ses appareils pour une écoute hors connexion[65]. Depuis août 2010, grâce à un partenariat avec Orange (géant français des télécommunications), un accès à l’offre Premium est compris dans certains forfaits de téléphonie mobile. Le service Deezer est offert au Canada depuis avril 2012. Il n’a pas encore été lancé aux États-Unis.
L’interface de Deezer[66] est organisée par onglets de navigation. L’onglet À écouter est celui qu’on voit par défaut à l’ouverture de l’application. On y trouve d’abord un bouton pour lancer le Flow, qui est un mix musical automatisé et personnalisé à partir de l’historique d’utilisation, des titres indiqués comme favoris ainsi que de nouveaux titres jugés comme correspondant aux goûts de l’utilisateur. De cette manière, le Flow fait jouer à la fois des titres déjà enregistrés dans la sonothèque virtuelle de l’utilisateur et des titres qui lui sont inconnus. Des boutons J’aime et Je n’aime pas permettent d’indiquer les pièces à éviter et celles à ajouter aux Coups de cœur, ce qui améliore en retour la formule de recommandation pour qu’elle « s’adapte aux goûts » de l’utilisateur[67]. On trouve sous le bouton Lancer Flow un choix de deux albums à écouter, choisis parmi ceux qui sont déjà enregistrés. Sous le Flow et ces deux albums débute la section Recommandé pour vous aujourd’hui, où s’affiche une série de vignettes (ou « fiches ») de recommandations musicales personnalisées. On y trouve des recommandations de titres, d’albums, de playlists et de « radios » ; elles sont présentées en ordre chronologique, parfois avec la mention « Sélection Deezer », « Conseillé par ___, Deezer Editor », « Nouveauté » ou encore « Vous aimez ___, Essayez ___ ». On peut lire et écrire des commentaires au bas de certaines de ces vignettes, et un bouton de lecture permet de lancer l’écoute des titres recommandés. L’onglet Explorer affiche une sélection de titres et d’albums classés par genre musical et par zone géographique. L’onglet Top Écoutes affiche les titres, albums, artistes et playlists les plus écoutés du moment sur Deezer. L’onglet Radios présente une sélection de « radios intelligentes » générant automatiquement une programmation musicale à partir des titres d’un artiste en particulier, auxquels s’ajoutent des titres d’artistes jugés similaires. Les Applications, situées sous ces onglets, sont des portails qui permettent d’accéder au contenu Deezer, mais à partir de l’interface d’un service tiers, par exemple la maison de disque Deutsche Grammophon ou encore le service Chordify. Au moment des entretiens, l’application Disney était présente par défaut dans la section Applications de l’interface.
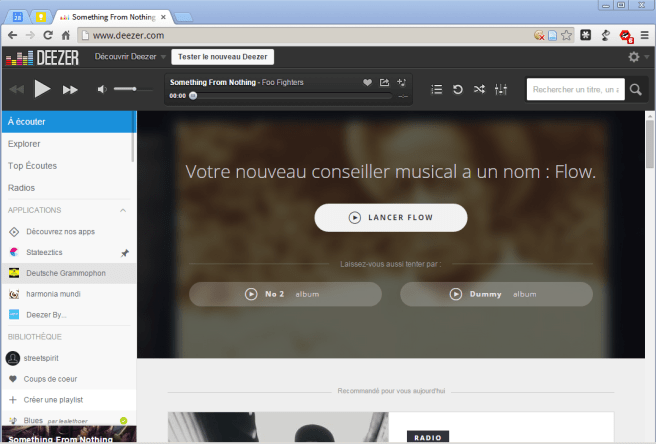
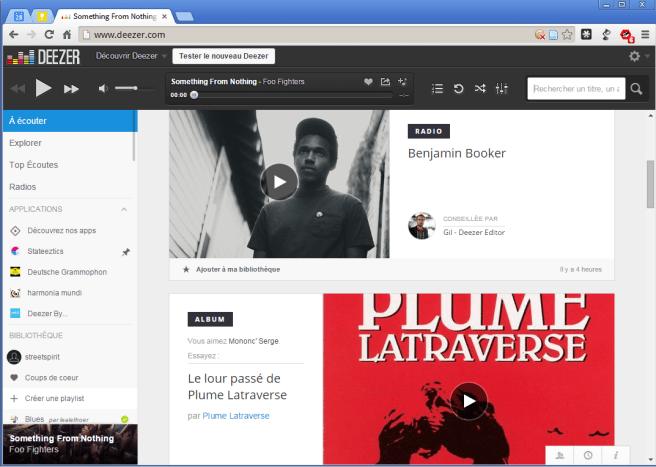
Figure 5 — Interface de Deezer (octobre 2014)
La section Bibliothèque, sous les applications, regroupe la page profil de l’utilisateur ainsi que la liste de ses playlists. On trouve sur cette page de profil une liste des titres, albums et artistes « coups de cœur », c’est-à-dire ceux que l’utilisateur a enregistrés, une liste des utilisateurs suivis et qui suivent l’utilisateur — Following et Followers — ainsi qu’un historique d’écoute. Une boîte en haut à droite permet d’effectuer une recherche par titre, album ou artiste. Les pages dédiées aux artistes présentent d’abord un Top Titres des cinq titres les plus écoutés pour cet artiste, puis sa discographie en ordre chronologique, du plus récent album au plus ancien. Enfin, trois boutons en bas à droite de l’interface affichent la liste des amis Facebook de l’utilisateur qui sont eux aussi connectés à Deezer, ainsi que des notifications qui indiquent ce que ces amis écoutent.
Spotify et Shazam
Spotify, principal concurrent de Deezer, est lancé en Suède en octobre 2008. Comptant en date du 10 juin 2015 plus de 75 millions d’utilisateurs, dont 20 millions d’abonnés payants[68], il s’agit de la plateforme musicale la plus populaire en son genre en ce moment[69]. Comme sur Deezer, on y a accès à un catalogue d’un peu plus de 30 millions de titres qu’on peut écouter sur demande ; comme sur Deezer, l’écoute entrecoupée de publicités y est gratuite et l’écoute illimitée coûte 10 € (ou 10 $ CA) par mois. Le catalogue de chansons de Spotify ressemble à celui de Deezer, mais les méthodes de recommandation y sont différentes. La fonction Flow de Deezer, par exemple, n’a pas d’équivalent sur Spotify, mais on y trouve en revanche une playlist personnalisée de 30 titres recommandés, renouvelée de manière hebdomadaire. Spotify est offert dans 58 pays, dont les États-Unis. Le service est offert en France depuis octobre 2008, et au Canada depuis septembre 2014.
L’interface de Spotify, relativement semblable à celle de Deezer et utilisée par un seul de nos répondants, ne sera pas décrite dans le détail. La page d’accueil de Spotify se distingue de celle de son concurrent en affichant non pas des recommandations de pièces ou d’albums, mais plutôt une liste de playlists choisies en fonction du moment de la journée — Dinner Music en soirée par exemple — ainsi qu’une grille « Genre et Ambiances » qui permet de lancer des playlists, comme le nom l’indique, crées par Spotify autour d’un thème, d’un contexte d’écoute ou d’un genre musical particulier, par exemple Hip hop, Entraînement, Trending, Sommeil.
Les applications mobiles Track ID et Shazam, utilisées par plusieurs de nos répondants, permettent d’identifier les pièces musicales pendant qu’elles jouent autour de soi. L’application, dès qu’elle est lancée sur téléphone intelligent, enregistre quelques secondes du son ambiant, interroge sa base de données sur le Web et retourne le nom du titre et son artiste[70]. Très efficace, l’application permet de retrouver à la fin de la journée, sur Deezer, Spotify ou YouTube, la liste des pièces ayant attisé la curiosité de l’utilisateur pendant la journée, en voiture ou au café par exemple.
La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique
L’offre des services de diffusion musicale est à peu près équivalente : accès à un peu plus de 30 millions de titres, applications Web et mobiles, écoute gratuite entrecoupée de publicités ou écoute illimitée pour 10 € (ou 10 $ CA) par mois. Là où les plateformes de diffusion ont l’occasion de se démarquer est dans la recommandation musicale et son interface. Avec autant de titres disponibles, comment choisir quoi écouter ? Les plateformes de diffusion numérique comme Deezer et Spotify ouvrent la voie à de grands changements dans le domaine de la recommandation culturelle, alors que se développe la recommandation personnalisée et automatisée alimentée par les mégadonnées (big data).
L’ouvrage Music Recommendation and Discovery d’Oscar Celma, publié en 2010 d’après sa thèse de doctorat, figure parmi les meilleures publications sur le sujet[71]. Telle qu’elle est présentée par Celma, la consommation musicale est centrée autour d’un petit nombre d’artistes énormément populaires. En 2007 aux États-Unis, seulement 1 % des titres offerts au format numérique représentaient 80 % des ventes, et 1000 albums seulement représentaient 50 % des ventes totales d’albums[72]. Dans un univers musical dominé sans partage par Taylor Swift et les bandes originales de Disney, la recommandation personnalisée par plateforme numérique offre un potentiel de diversification énorme ; elle présente l’occasion pour le nombre grandissant d’utilisateurs des services comme Deezer et Spotify de s’ouvrir à la nouveauté[73]. Pour l’instant, c’est encore une minorité d’artistes très populaires qui domine sur Deezer : « 30 % des écoutes d’un morceau [n’y] durent pas plus de 30 secondes », « 50 % [des écoutes] ne vont pas jusqu’à la fin [des morceaux] » et « seulement 20 % » des albums présents sur la plateforme sont écoutés « de manière significative »[74]. Cependant, il faut souligner que les outils de recommandation tels qu’ils sont présents aujourd’hui sur Deezer sont très récents. Les onglets À écouter et Explorer sont annoncés pour la première fois sur le blogue de l’entreprise en novembre 2013[75] ; la fonctionnalité Flow apparaît quant à elle progressivement sur la plateforme à partir d’avril 2014[76], soit quelques mois seulement avant nos entretiens.
La recommandation musicale est unique à bien des égards si on la compare à celle pour les films ou les livres par exemple. Les goûts et les préférences des auditeurs sont déterminés de manière plus implicite qu’explicite, c’est-à-dire par rapport à leurs habitudes d’écoute sur la plateforme plutôt qu’à leurs évaluations explicites des contenus musicaux. Un même titre peut être écouté plusieurs fois ou joué en boucle. Les recommandations musicales peuvent être évaluées de manière instantanée par l’écoute d’extraits ; le service YouTube à lui seul permet aujourd’hui d’écouter pratiquement n’importe quel titre ou album le moindrement populaire dans son entièreté, gratuitement. Le contexte d’écoute exerce une influence considérable sur les choix musicaux : un même utilisateur peut très bien écouter de la guitare acoustique en se levant le matin, du hip-hop en s’entraînant au gym et du jazz en s’endormant le soir. Un service de recommandation musicale efficace doit non seulement présenter les bons titres, il doit les présenter au bon moment[77].
L’objectif de la recommandation, explique Celma, est la sérendipité (serendipity), c’est-à-dire la découverte de titres à la fois pertinents et nouveaux pour un utilisateur particulier. Un équilibre très délicat entre familiarité et nouveauté doit être atteint : les titres très populaires risquent d’être déjà connus par l’utilisateur, et ceux plus obscurs, même s’ils correspondent précisément à ses goûts, sont abordés avec méfiance. Une série de titres familiers doit être présentée d’emblée, pour faire place à des recommandations de plus en plus pointues au fur et à mesure que l’outil de recommandation gagne la confiance de l’utilisateur[78]. Deuxième défi de taille, les goûts changent avec le temps, ce qui nécessite l’adaptation constante de la formule de recommandation. La rétroaction (feedback) positive de l’utilisateur s’exprime de manière implicite dans ses choix d’écoute et dans les titres et les albums qu’il enregistre dans ses favoris, mais la rétroaction négative, forcément explicite (appuyer sur un bouton Je n’aime pas par exemple), est plus difficile à soutirer, puisqu’elle exige un effort supplémentaire de l’utilisateur.
Il existe trois catégories principales de formules de recommandation musicale[79] :
- Le filtrage démographique : associe certains traits et certaines caractéristiques (âge, sexe, situation familiale, ville, intérêts, etc.) à certains artistes ou styles musicaux. Par exemple, on demande à l’ouverture du compte Deezer l’âge de l’utilisateur ainsi qu’une sélection de styles musicaux favoris parmi une liste, afin de fournir les premières recommandations. Les recommandations basées sur cette seule technique demeurent très générales, ce qui n’est pas efficace à long terme. Aussi, remplir tout type de formulaire demande un effort de la part de l’utilisateur, ce qui représente un deuxième inconvénient.
- Le filtrage collaboratif : associe entre eux les utilisateurs qui affichent des goûts et des comportements semblables, en s’intéressant aux liens entre utilisateurs et titres musicaux sur l’ensemble de la plateforme. Par exemple, si la majorité des utilisateurs qui écoutent les artistes A, B et C écoutent aussi l’artiste D, on va recommander cet artiste D à ceux qui écoutent A, B et C sans écouter D. Le filtrage collaboratif est parmi les méthodes de recommandation les plus utilisées, pour la musique comme pour les achats en général (la section « Les clients qui ont acheté cet article ont aussi acheté » figurant sur les pages de produits Amazon en est un bon exemple). Cela dit, cette méthode a ses inconvénients. D’abord, avec plus de 30 millions de titres au catalogue Deezer, dont une petite partie seulement est écoutée de manière significative, on ne dispose pas d’assez d’information sur la majorité des titres disponibles pour pouvoir les recommander de manière fiable. Aussi, dès qu’un utilisateur dévie un peu de la norme dans ses goûts, il devient difficile de lui trouver des utilisateurs correspondants. Ensuite, il est difficile d’établir des recommandations pour les nouveaux utilisateurs et les nouveaux titres musicaux, qui n’ont pas établi assez de liens pour qu’on puisse les associer : c’est le problème du démarrage à froid (cold start). Enfin, le filtrage collaboratif, en se basant sur le comportement des utilisateurs plutôt que sur la description du contenu, tend à recommander les titres les plus populaires, ce qui accentue le problème de la dispersion des données et laisse dans l’ombre un grand nombre de titres potentiellement très pertinents.
- Le filtrage basé sur l’analyse du contenu: associe les préférences des utilisateurs aux caractéristiques des titres musicaux (genre, vitesse, langue, instruments, etc.), telles qu’elles sont déterminées par des évaluateurs humains ou une formule informatique automatisée ; on s’intéresse aux similarités entre les titres. Cette méthode est elle aussi sujette au problème du démarrage à froid : on peut difficilement recommander des titres à un utilisateur dont on ignore les préférences. Le filtrage par analyse de contenu peut mener à des recommandations limitées, qui ressemblent trop aux titres déjà présents dans les favoris de l’utilisateur — ce qui va à l’encontre de l’objectif de sérendipité recherché. Il y a de bonnes chances que ces titres soient déjà connus, ou que certains genres musicaux très appréciés de l’utilisateur demeurent absents des recommandations, si aucun morceau de ce style n’est présent dans les favoris.
… auxquelles vient s’ajouter une quatrième catégorie issue des progrès technologiques des dernières années :
4. Le filtrage basé sur le contexte : extrait de l’information sur les titres, les albums et les artistes sur le Web, les réseaux sociaux et les services d’identification collaboratifs (collaborative tagging, comme sur le service Last.fm par exemple). Un peu à la manière du moteur de recherche Google, cette formule extrait toute l’information qu’elle peut trouver sur le Web à propos de la musique : texte, hyperliens, contenu multimédia, évaluations de consommateurs, forums de discussion, sessions de clavardage, réseaux sociaux. Cette information est ensuite analysée de manière à identifier les opinions et les tendances musicales pour chaque tranche démographique d’utilisateurs. Elle sert aussi à identifier les catégories associées aux titres musicaux, telles qu’elles sont attribuées par les auditeurs et dans leurs propres mots. Cette méthode rencontre les problèmes de la polysémie et de la synonymie : est-ce que le verbe « aimer » signifie que l’internaute apprécie la pièce, ou que cette pièce parle d’amour ? Doit-on regrouper ou non les titres identifiés par les internautes comme étant « hiphop », « hip-hop » et « rap » ? Un autre problème est que, en règle générale, seuls les titres les plus populaires sont identifiés par les internautes.
Ces quatre méthodes de recommandation sont combinées sur les plateformes de diffusion dans une formule hybride qui tire profit des forces et des faiblesses de chacune. Par exemple, on va se fier au filtrage démographique pour les recommandations d’un nouvel utilisateur, afin de remédier au problème du démarrage à froid associé au filtrage collaboratif. Considération importante, les recommandations doivent absolument être transparentes : « les explications justifiant les recommandations sont aussi importantes que la liste d’éléments recommandés elle-même »[80]. En effet, il a été démontré que ces explications accroissent la satisfaction des utilisateurs et leur confiance en la formule de recommandation, en particulier pour les systèmes basés sur le filtrage collaboratif[81].
Les formules de recommandation de Deezer et Spotify
Les formules de recommandation et leur interface sont différentes sur Deezer et Spotify, mais elles s’alimentent à une seule et même base de données, celle de la compagnie Echo Nest. Fondée en 2005 par Tristan Jehan et Brian Whitman, deux doctorants au MIT Media Lab, puis achetée par Spotify en 2014, elle alimente aujourd’hui plus de 400 applications et sites Web tels que Deezer, VEVO, MTV, Foursquare, Twitter, Yahoo! et Microsoft, et rejoint plus de 100 millions d’usagers chaque mois[82]. Si vous avez utilisé un service musical en ligne autre que Pandora et iTunes, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà eu affaire à Echo Nest sans le savoir[83].
Echo Nest est beaucoup plus qu’une base de données ; il s’agit d’une infrastructure complète de veille, de collecte et de réorganisation (repackaging) de données culturelles et comportementales sur laquelle vient s’établir une multitude d’applications et de services musicaux[84]. La base de données Echo Nest renferme non pas des contenus culturels, mais plutôt des liens et des connexions entre artistes, utilisateurs et contenus. Ce sont les plateformes telles que Spotify et Deezer qui négocient l’accès aux œuvres avec les compagnies de production ; Echo Nest ne fournit que le moteur de recommandation. L’accès à cette infrastructure se fait par l’intermédiaire de son interface de programmation d’applications (API). Fait intéressant, cet accès est libre et gratuit pour toute utilisation non commerciale, et le service d’identification Echoprint est libre d’accès même pour utilisation commerciale — ce qui explique le nombre élevé d’applications et de services qui y ont recours. Ce modèle très ouvert alimente généreusement en retour la base de données, qui devient ainsi plus riche de jour en jour. Chaque utilisateur d’Echo Nest, sur n’importe quelle plateforme, est suivi dans ses recherches et ses écoutes en temps réel. Le nom des titres écoutés, l’heure et l’emplacement géographique de ces écoutes ainsi que tout favori ou titre sauté sont enregistrés dans un profil d’utilisateur persistant et anonymisé, nommé Taste Profile[85].
L’équipe de recherche responsable du moteur de recommandation Echo Nest est très active sur le Web : au blogue grand public Spotify Insights[86] et à celui, plus technique, de ses ingénieurs Spotify Labs[87] viennent s’ajouter les blogues personnels bien garnis de ces mêmes employés. On y décrit les derniers projets de la compagnie, des données d’utilisation intéressantes ou encore les difficultés techniques rencontrées par les ingénieurs au quotidien. Brian Whitman, co-fondateur d’Echo Nest et scientifique en chef chez Spotify, explique dans son article How music recommendation works – and doesn’t work le fonctionnement du moteur de recommandation musicale qu’il a conçu[88].
Les approches de recommandation basées sur les comportements d’écoute et l’évaluation éditoriale, explique Whitman, ont échoué dans leurs efforts de recommandation, et c’est dans l’objectif de remédier à la situation qu’Echo Nest a été fondé. Sa nouvelle approche, basée sur « l’analyse acoustique » et « l’analyse textuelle » — qui correspondent respectivement à l’ « analyse du contenu » et au « filtrage basé sur le contexte » décrits à la section précédente —, vise deux objectifs cruciaux de la recommandation qui ont été négligés à son avis par les approches précédentes, soit le souci des artistes et des auditeurs (Care) et la portée du catalogue de titres disponibles (Scale). Est-ce que l’outil de recommandation propose des titres véritablement pertinents et nouveaux à ses utilisateurs ? Permet-il aux nouveaux musiciens de se faire découvrir ? Sa base de données considère-t-elle une minorité d’artistes très populaires ou englobe-t-elle aussi les artistes moins connus ?
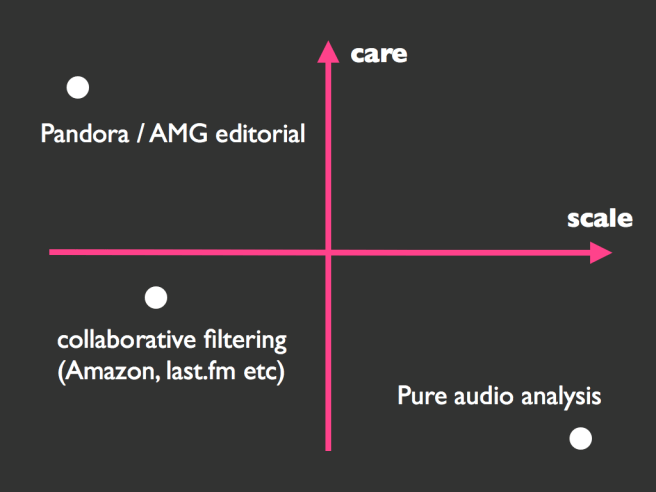
Figure 6 – Les techniques de recommandation et leur performance en termes de Care et Scale (How Music Recommendation Works, Whitman)
Le filtrage collaboratif du site marchand Amazon, par exemple, est conçu pour encourager un nombre maximum d’achats, mais en tant qu’outil de recommandation culturel, observe Whitman, il laisse à désirer. On peut se demander, par exemple, quelle est la pertinence informationnelle d’afficher, sur la page de l’album Revolver des Beatles, cinq autres albums des Beatles en guise de recommandation. Il y a là une belle occasion de découverte qui est gâchée, autant pour l’auditeur que pour les artistes émergents — d’où le constat d’échec quant à l’aspect care de la formule. Les services musicaux comme Pandora, qui fondent leurs recommandations sur l’analyse des contenus musicaux plutôt que sur le filtrage collaboratif, proposent des titres plus pertinents, de véritables découvertes. Cela dit, explique Whitman, Pandora en particulier souffre d’un problème d’échelle : chaque titre étant classé manuellement par ses musicologues, sa base de données comprend à peine un peu plus d’un million de titres après 10 ans d’existence[89] – très loin des 30 millions de Deezer et de Spotify. En épluchant plus de 10 millions de pages Web sur la musique par jour, le moteur de recommandation d’Echo Nest suit le pouls de l’actualité musicale telle qu’elle est vécue et décrite par les internautes — Whitman affirme que son entreprise est la seule à privilégier cette approche. Cette analyse textuelle, combinée à une analyse acoustique automatisée, produit une base de données à la fois d’une grande richesse et d’une grande envergure.
Si l’infrastructure fondamentale d’Echo Nest est commune à Deezer et Spotify, les formules précises de recommandation diffèrent sur chaque plateforme. Sans en connaître les détails — secret commercial oblige —, on sait, par exemple, que Deezer se démarque en ajoutant dans sa recette « le scan de 1 500 radios […] pour apprendre de leurs associations et choix sonores, et les choix de 50 personnes [les Deezer Editors], chargées de repérer des disques dans l’actualité »[90].
Tel qu’il a été mentionné précédemment, plusieurs centaines de services et d’applications ont été conçus ces dernières années à l’aide de la base de données Echo Nest. Parce qu’une portion significative de cette infrastructure est libre d’accès, ces applications proviennent autant des ingénieurs de Spotify que de concepteurs indépendants. En voici quelques-unes, pour donner une idée de ce que permet aujourd’hui l’analyse des données des plateformes musicales[91] :
- Fresh Finds[92]: une playlist de titres émergents, renouvelée tous les mercredis. L’analyse des grands titres de l’actualité musicale et du bouche à oreille sur les blogues et les forums que permet le moteur de recommandation de Spotify y indique les pièces musicales qui gagneront en popularité au cours des prochaines semaines, avant même qu’elles aient été écoutées de manière significative sur la plateforme.
- Musical Map[93]: carte du monde interactive où on peut voir les titres populaires distinctifs du moment chez les utilisateurs de Spotify de chacune des grandes villes où le service est présent, c’est-à-dire des titres qui sont populaires à cet endroit, mais pas ailleurs. Au moment d’écrire ces lignes, ce sont Jean Leloup et Les sœurs Boulay qui se démarquent à Montréal, Billy Redfield et Lisa May à Berlin et The Shoes et Lilly Wood and the Prick à Paris.
- Every Noise At Once[94]: carte interactive des 1387 genres musicaux répertoriés par Echo Nest. On y voit la relation des genres entre eux, ainsi qu’une liste des artistes les plus représentatifs dans chacun des genres. Voir aussi Music Popcorn[95], un autre projet de visualisation des genres musicaux.
- Where’s the Drama?[96] : identifie et joue l’extrait de 30 secondes le plus « dramatique » de n’importe quel titre disponible sur Spotify, c’est-à-dire celui où un important crescendo culmine en un sommet en termes de volume. Testé avec Stairway to Heaven de Led Zeppelin et All By Myself de Céline Dion, la formule identifie correctement le solo de guitare et les notes aiguës de la chanteuse. Ça marche !
- The Drop Machine[97]: trouve et joue les drop dans les pièces de musique électronique, ce point culminant où démarre une trame basse très rythmée. Cet outil fonctionne non pas en calculant l’amplitude sonore des pièces, mais plutôt en compilant les données de navigation et de zapping (scrubbing) de millions d’utilisateurs à l’intérieur de ces pièces. Dans une pièce rock, les auditeurs vont avancer le curseur pour entendre directement le solo de guitare par exemple ; dans une pièce dubstep c’est invariablement le drop qui est recherché.
- Taste Freeze[98]: recherche d’Ajay Kalia de chez Spotify sur le phénomène de la cristallisation des goûts musicaux avec l’âge, observé et documenté d’après les données de la plateforme de diffusion. Les goûts musicaux des adolescents convergent en grande majorité vers des artistes très populaires, pour ensuite s’éloigner de ces artistes au cours de la vingtaine, et se cristalliser en début de trentaine. Cet effet est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.
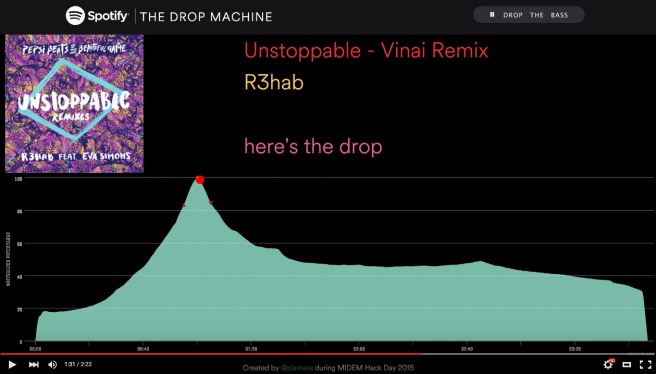
Figure 7 – The Drop Machine (vidéo de l’application en action)
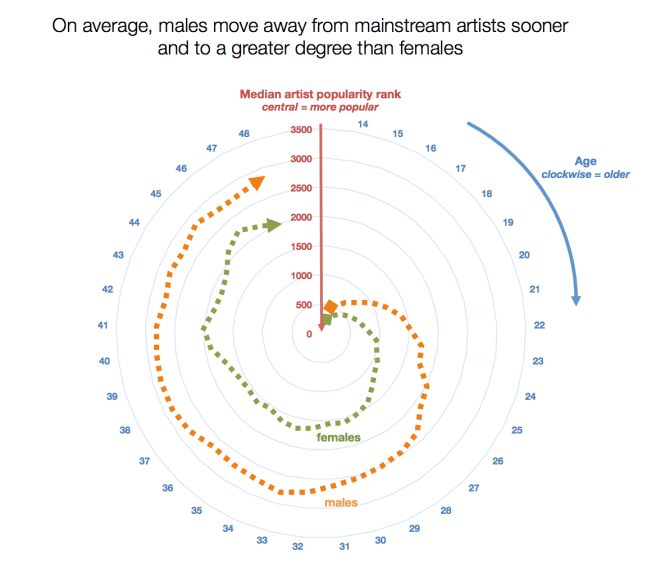
Figure 8 — Rang de popularité des artistes écoutés selon l’âge (Recherche Taste Freeze)
Méthodologie ⇑
La première partie de ce rapport ayant tracé un portrait général de la situation de la consommation musicale et de ses nouvelles plateformes de diffusion, la seconde partie porte maintenant sur l’analyse de dix entretiens menés avec des utilisateurs de ces nouvelles plateformes musicales. À la suite d’Hennion et de Granjon et Combes, ayant respectivement étudié l’incidence du CD et de la numérisation des pièces musicales, la présente recherche tente de découvrir l’effet de la transformation des biens musicaux en services de diffusion musicale, tel qu’il est exprimé et observé chez les utilisateurs de ces services. Plus spécifiquement, elle se penche sur la réception chez ces utilisateurs des nouveaux outils de recommandation musicale mis à leur disposition, tels que le Flow et les fiches de la page d’accueil du service Deezer. Les principaux objectifs de la recherche sont les suivants :
- Tracer le portrait des transformations de la consommation musicale chez les répondants au cours des dernières années.
- Définir la manière dont les répondants découvrent de nouveaux titres et de nouveaux artistes musicaux aujourd’hui. Quelle place occupent les nouvelles plateformes de diffusion dans ce processus de découverte ?
- Observer comment ces plateformes sont utilisées par les répondants, et ce qu’ils comprennent des outils de recommandation qui leur sont proposés.
Les participants ont été sélectionnés parmi ceux de l’Étude sur la perception du traitement des données personnelles sur Internet d’Orange Labs, un sondage Web mené à l’été 2014 auprès de 1000 Français âgés de 15 ans et plus. Les participants ne pouvaient être sélectionnés pour la présente étude que s’ils remplissaient tous les critères suivants :
- Habite la grande région parisienne[99].
- Indique écouter de la musique sur une plateforme de diffusion en continu (comme Deezer et Spotify) une fois par semaine ou plus.
- Indique être intéressé à participer à une seconde étude.
- Spécifie son adresse et son numéro de téléphone[100].
Des 1000 participants au sondage, seulement 30 correspondaient à tous ces critères. Parmi eux, 10 ont accepté notre invitation : ils sont devenus notre échantillon. Notre groupe de répondants est composé de 2 femmes et 8 hommes, âgés de 21 à 54 ans. Deezer est la plateforme de choix de 8 d’entre eux ; un autre utilise plutôt Spotify, et un autre se sert seulement de YouTube[101].
Les entretiens ont été menés d’une manière semi-directive, c’est-à-dire avec une grille de questions flexible qui permet une certaine adaptation aux réponses du participant, selon les thèmes qui émergent spontanément dans ses réponses par exemple. Ils ont eu lieu au domicile des participants et avec leur propre équipement[102], dans l’idée de documenter une utilisation des plateformes de diffusion en continu qui soit la plus authentique possible.
Le questionnaire était constitué des sections suivantes[103] :
- Réitération des objectifs du projet et des considérations liées à l’éthique (confidentialité des réponses, liberté de refuser de répondre à certaines questions, etc.).
- Confirmation des informations personnelles: âge, occupation, niveau d’études.
- Contextes d’écoute: fréquence, équipement, moyen d’acquisition, montant dépensé, transformation de la consommation.
- Plateforme de diffusion: type d’abonnement, nombre d’années d’utilisation, motivation à l’abonnement, transformation de l’écoute s’il y a lieu, connexion du service à un réseau social comme Facebook.
- Découverte musicale: description de découvertes anciennes et récentes, classement des outils de découverte (télévision, presse, amis, réseaux sociaux, plateformes de diffusion) et de la provenance des titres écoutés (ce qu’écoutent les amis, ce que recommandent les experts, recommandations de la page d’accueil, titres tirés des favoris déjà enregistrés, titres trouvés ailleurs, par exemple en écoutant la radio FM ou sur YouTube).
- Interface de la plateforme: description étape par étape de l’utilisation de la plateforme par le répondant dans un de ses contextes d’écoute (« je clique ici », « je regarde ici », etc.), utilisation et compréhension du Flow et des fiches de recommandation (« à votre avis, pourquoi Deezer vous recommande-t-il cet artiste ? »), commentaires sur les différents onglets de l’interface et l’historique d’écoute.
- Écoute sur téléphone intelligent et ardoise numérique (s’il y a lieu): description étape par étape de l’utilisation de la plateforme sur ces supports dans un de ses contextes d’écoute, différences avec l’interface régulière.
La grille de questions a été testée à deux reprises avant le début officiel des entretiens, auprès d’une collègue étudiante à Orange Labs (utilisatrice de Deezer) et de mon superviseur Jean-Samuel Beuscart (Spotify). L’étude des habitudes d’utilisation de Deezer et de Spotify pour nos répondants s’est faite par observation directe et par une mise en contexte qui ressemble à l’approche des « incidents critiques » de Flanagan[104]. Cette approche consiste à demander aux répondants comment ils agissent en certains contextes précis et concrets, ou encore de relater leurs expériences personnelles, plutôt que de leur poser des questions hypothétiques. Par exemple, poser la question « quel est votre artiste favori et comment l’avez-vous découvert ? » plutôt que « comment découvrez-vous de nouveaux artistes ? », une formulation qui peut faire figer la personne interviewée[105].
J’ai enregistré puis retranscrit les 10 entretiens, d’une durée moyenne d’environ 1 heure 15 minutes. Les retranscriptions comptent un peu plus de 10 000 mots par entretien. Le texte des entretiens a ensuite été codé à l’aide du logiciel d’analyse QDA Miner de l’entreprise montréalaise Provalis Research[106]. L’analyse des données a été effectuée selon une approche abductive, c’est-à-dire dont l’explication théorique est fondée sur l’expérience et la perspective des participants eux-mêmes. Le processus de codage s’est fait en deux étapes : une phase initiale où ont été dégagés les thèmes principaux, puis une phase de recodage sélective où certaines catégories ont été combinées et d’autres, aux passages particulièrement riches, subdivisées pour plus de précision[107].
Il est important de noter les limites de cette recherche. Tout d’abord, il faut souligner qu’elle ne s’intéresse qu’à des répondants de la grande région parisienne. La première partie de ce rapport trace le portrait général de la consommation musicale contemporaine en France, au Québec et aux États-Unis, mais l’analyse qualitative qui suit concerne avant tout des utilisateurs français de plateformes de diffusion musicale. Ensuite, cette analyse est fondée sur les entretiens seulement. Il aurait été intéressant d’avoir accès aux données d’utilisation de nos répondants telles qu’elles sont recueillies chez Deezer et Spotify par exemple, afin de pouvoir comparer le récit de leurs expériences sur la plateforme avec des données chiffrées. Cela dit, le fait d’observer l’utilisation de la plateforme en personne, chez les répondants et sur leur propre matériel, permet une analyse beaucoup plus riche que ce que les chiffres seuls pourraient révéler. Finalement, le processus de sélection des participants est sans aucun doute la plus importante limite de cette étude. Ces derniers, tel qu’il a déjà été mentionné, n’ont pas été sélectionnés selon une méthode particulière : il s’agit simplement de l’entièreté du groupe de participants qui répondaient à certains critères et ont accepté notre invitation, parmi les participants d’une enquête antérieure. Notre échantillon est malgré tout assez balancé, du moins au point de vue de l’âge et du profil socio-économique des participants. Cela dit, les femmes sont sous-représentées dans notre échantillon, qui en compte deux sur dix participants. Il faut noter que le point de saturation n’a pas été atteint : chaque nouvel entretien faisait découvrir de nouvelles pratiques. Notre enquête est avant tout exploratoire, et vise à fournir des pistes de réflexion qui pourront être approfondies dans de nouveaux projets de recherche.
Cette enquête a été approuvée par le Comité d’éthique de l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Suivant les recommandations de l’Énoncé de Politique des Trois Conseils sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains[108], une lettre d’information a été envoyée par courriel aux participants une semaine avant les entretiens afin d’assurer leur consentement éclairé[109], confirmé ensuite par écrit le jour de l’entretien. Le nom des participants a été modifié dans ce rapport et le texte des entretiens anonymisé, au besoin, afin d’assurer la confidentialité des participants. Un chèque-cadeau d’une valeur de 20 €, offert par Orange, leur a été remis à la fin des entretiens.
Portraits des participants ⇑
Julie (24 ans)
Étudiante/stagiaire dans une boîte de production
Master 2 Journalisme
Deezer (gratuit)
« [Le streaming] ça fait découvrir plus de musique en moins de temps, et en même temps… la musique, on ne l’écoute pas »
Julie est une « monomaniaque » autoproclamée de la musique. Ayant grandi dans une famille de musiciens et terminant aujourd’hui ses études en journalisme, son objectif de carrière est de devenir critique musicale professionnelle. Julie écoute de la musique « tout le temps », le plus souvent sur son ordinateur : à la maison, dans les transports, même au travail (où « elle n’a pas vraiment le droit »). Elle se procure sa musique presque exclusivement par téléchargement illégal, grâce à l’application Deezify qui lui permet de télécharger au format MP3 n’importe quel titre du catalogue Deezer[110]. Elle effectue ses rares achats de chansons sur iTunes, seulement dans les cas où c’est le seul endroit où elle peut trouver ce qu’elle cherche. Julie dit dépenser environ 30 € par an pour l’achat de pièces musicales (elle achète parfois des vinyles), et de 100 à 400 € par an (ou plus) pour assister à des concerts et à des festivals. Elle carbure à la découverte : elle maintient une liste de découvertes et de nouveautés à écouter dans un fichier Word, une liste qui se remplit tellement vite qu’elle n’arrive jamais à en venir à bout. Elle écoute ces nouveautés sur YouTube et sur Deezer, où elle zappe rapidement dès qu’elle a le moindre doute sur une pièce. Elle laisse jouer les albums qui lui plaisent, pour ensuite les télécharger avec Deezify, puis les ajouter à iTunes, sa sonothèque principale. Dans ses propres mots, son écoute c’est « du tri, du tri, du tri ». Julie a un problème avec les recommandations musicales de Deezer : dans la plupart des cas, elle connaît déjà les groupes qu’on lui propose.
Karim (33 ans)
Ingénieur en informatique, spécialiste réseau
Doctorat en informatique
Spotify (gratuit)
« J’ai laissé tomber tout ce qui était… moyen archaïque d’écoute de musique »
D’origine tunisienne, Karim habite Paris avec sa femme depuis le début des années 2000. Ingénieur en informatique, il est particulièrement au fait des procédés de recommandation. Karim écoute de la musique « tous les jours », chez lui en se préparant le matin par exemple, et surtout au travail où la musique dans ses écouteurs lui permet de mieux se concentrer (il travaille en aire ouverte). Il « essaie de ne pas payer pour la musique ». N’ayant acheté « que deux CD dans toute sa vie », il téléchargeait illégalement sa musique il y a quelques années, pour ensuite se graver des CD musicaux personnalisés. Ce sont les plateformes de diffusion en continu, d’abord YouTube, puis Spotify, qui comblent aujourd’hui tous ses besoins musicaux. Il « ne stocke rien » sur son ordinateur, ni musique, ni films, et considère les supports physiques (CD, DVD) comme étant « archaïques ». Comme il le dit, « on trouve toujours ce qu’on veut sur Internet ». Karim s’intéresse peu aux recommandations de YouTube et de Deezer. Il utilise ces plateformes comme des bases de données, et se contente de chercher les titres qu’il veut écouter un à un, en écrivant le nom d’un artiste ou d’une pièce dans la boîte de recherche, au gré de ses envies. Il ne cherche pas à découvrir de nouveaux artistes sur ces plateformes ; il « sait déjà ce qu’il veut écouter », et « laisse les recommandations venir à lui », par exemple à travers ce qu’il entend à la télévision. Karim ne met jamais de titres ou d’artistes dans ses favoris parce que « ce qu’il aime change » et, de toute façon, « il n’aime que deux ou trois chansons par artiste ».
Stéphane (45 ans)
Service client, magasin de bricolage
Bac +3, licence procommerce
Deezer (Premium, avec forfait Orange)
« J’achète plus de musique depuis que j’ai Deezer… le but d’avoir mis Deezer sur le PC c’était de ne plus acheter de CD en fait »
Stéphane travaille au service client d’un magasin de bricolage[111]. Il écoute de la musique dans trois contextes différents : à la maison (sur son ordinateur), en faisant du sport (sur son téléphone intelligent) et dans les transports, en voiture (radio) et dans le bus (téléphone intelligent). Stéphane s’est récemment débarrassé de la plus grande partie de ses CD : il en a gardé une vingtaine et a mis le reste au recyclage. Avec Deezer, Stéphane écoute toute la musique qu’il veut sans avoir à acheter quoi que ce soit, et sans disques à aller changer, ce qu’il trouve beaucoup plus pratique. Il découvre de nouveaux artistes surtout à la télévision : grâce à l’application Track ID installée sur son téléphone, il identifie les pièces qu’il y entend, pour ensuite les retrouver sur Deezer où il les ajoute à ses favoris. Stéphane adore partager ses découvertes musicales. Il le fait dans des forums de discussion sur le Web, en salle d’entraînement avec ses équipiers et dans des soirées entre amis où il fait le DJ, ouvrant plusieurs onglets Deezer et « mixant » ainsi les chansons en jouant avec leurs volumes. Stéphane écoute avant tout sa liste de titres favoris sur Deezer, toujours en mode aléatoire. Il jette un coup d’œil aux recommandations de la page d’accueil à l’occasion, mais c’est pour se renseigner à propos des nouveautés des artistes qu’il connaît déjà ; il n’est aucunement intéressé à écouter sur Deezer des artistes dont il n’a jamais entendu parler auparavant.
Céline (35 ans)
Marketing
Bac +5, école de commerce
Deezer (Premium, avec forfait Orange)
« L’avantage aussi, contrairement au CD, c’est qu’on peut prendre par morceaux et pas par albums complets. Parce qu’il peut y avoir un déchet sur un album, certains morceaux qu’on n’aime pas… »
Céline travaille dans le département marketing d’une grande entreprise et est la mère de deux petites filles. Elle écoute de la musique tous les jours, à la maison et en voiture. Pour elle, c’est un « fond sonore », « quelque chose d’agréable à écouter » pendant ses activités quotidiennes. Très équipée, Céline écoute Deezer sur sa télévision (grâce à l’application dédiée), sur sa tablette iPad et sur son téléphone intelligent. Elle possède une collection de deux cents CD « à la cave », mais n’en achète presque plus. Elle achète maintenant sa musique titre par titre sur iTunes, et estime y avoir dépensé ainsi environ 30 € dans les six derniers mois. Céline découvre de nouveaux artistes surtout en voiture, en écoutant la radio. Elle découvre et enregistre ses coups de cœur grâce à l’application Shazam installée sur son téléphone. Elle ajoute ces titres à ses favoris sur Deezer, et les classe ensuite dans des playlists liées aux contextes d’écoute (soirée entre amis, musique des chorégraphies de danse de ses filles, vacances, etc.). Céline est intéressée par les recommandations musicales de Deezer surtout quand on lui propose un artiste semblable à un autre qu’elle apprécie déjà. Nouvellement abonnée à Deezer, c’est « le côté réactif » de la plateforme qui lui plaît le plus, le fait de pouvoir écouter n’importe quel artiste dès qu’elle en a envie.
Julien (32 ans)
Juriste, fonction publique
Bac +5, droit
Deezer (gratuit)
« Hier je voulais écouter du Stevie Wonder. Ne serait-ce que pour 2014 il y avait 15 albums différents, des remix, des choses comme ça. À la lecture des titres, je ne reconnaissais pas ses tubes. J’ai écouté 4 ou 5 tubes, dans la rubrique du haut, les plus écoutés. Et donc j’ai dit, très bien, si c’est les plus écoutées, c’est que c’est les plus connues »
Julien est juriste dans la fonction publique. Il écoute de la musique le matin à la radio, en transports en commun avec son iPod et le soir et les fins de semaine sur son ordinateur avec Deezer. Il possède une centaine de CD, mais n’achète plus aucune musique aujourd’hui, que ce soit en disque (« une perte de place et une perte d’argent ») ou sur iTunes ; il n’écoute de la musique que sur YouTube et Deezer. Julien découvre de nouveaux artistes « plutôt à travers les médias traditionnels » comme la télévision et la radio. Il ouvre Deezer sachant d’avance ce qu’il veut écouter, et inscrit directement le nom du titre ou de l’artiste dans la barre de recherche. Il s’intéresse peu aux recommandations musicales de Deezer, qu’il juge « aléatoires » et basées avant tout sur « les artistes qui ont payé », sauf dans les cas où on lui annonce la parution de nouveaux albums d’artistes qu’il connaît et apprécie déjà. Julien s’était créé plusieurs playlists et identifiait ses titres favoris à ses débuts sur Deezer, mais a arrêté de le faire quand il a réalisé que plusieurs de ces titres étaient devenus soudainement inaccessibles[112]. Depuis, il se contente de la boîte de recherche ; « si ma mémoire flanche, c’est que je n’avais pas si envie que ça de le réécouter ».
Sébastien (39 ans)
Responsable service, restauration
CAP pâtisserie
Deezer (gratuit)
« Je ne mélange pas mes identifiants, sachant qu’on peut s’identifier Deezer via Facebook pour écouter de la musique. Je ne mélange jamais les comptes, c’est un principe que j’ai. »
Sébastien est responsable du service dans un restaurant. C’est lui qui s’occupe de choisir la musique à jouer dans l’établissement, le plus souvent du jazz étant donné la thématique de l’endroit. Il fait jouer des albums complets, soit à partir du iPod de l’entreprise, soit à partir d’un ordinateur connecté à Deezer. À la maison, Sébastien écoute la musique sur son ordinateur ; il avait une collection de disques et une chaîne stéréo pour les jouer, mais il s’en est débarrassé. Toute sa musique (sauf quelques CD de ses artistes préférés qu’il a gardés) est maintenant au format numérique, dans son disque dur externe, ou accessible en diffusion continue sur YouTube et Deezer. C’est « plus accessible » et « plus rapide » ainsi, sans disque à manipuler. Sébastien écoute surtout la musique sur YouTube et sur quelques Webradios ; Deezer lui sert à aller approfondir l’œuvre des artistes qu’il découvre sur ces plateformes de diffusion. Il ne souhaite pas découvrir de nouveaux artistes sur le service Deezer lui-même. Sébastien dit choisir la musique à jouer sur son ordinateur « selon ce qu’il ressent », selon l’émotion du moment.
Georges (43 ans)
Directeur d’école
Bac +4
Deezer (gratuit)
« Je ne suis pas très immatériel »
Georges est un mouton noir parmi les répondants : il continue à acheter des disques, plusieurs par mois (« ils sont là, regardez, il y en a partout »). Directeur d’école, il dit « être de l’ancienne génération », il lui faut absolument le support physique. En fait, « ça ne lui viendrait même pas à l’esprit de payer pour un produit immatériel », que ce soit un fichier musical sur iTunes ou encore un forfait Deezer Premium (il a un compte gratuit). Deezer est son « tremplin », sa « plateforme avant-achat ». Il lui arrivait fréquemment d’acheter un album sur un coup de tête ou selon la recommandation d’un ami, mais après quelques mauvaises surprises il préfère maintenant écouter d’abord sur Deezer pour tester, « s’imprégner » de l’album avant l’achat. Georges écoute ses CD sur sa chaîne haute-fidélité à la maison, et en extrait des fichiers musicaux sur iTunes pour pouvoir les écouter sur son iPod. Très occupé, il avoue qu’il « se pose rarement pour écouter de la musique », sauf juste avant de dormir et dans les transports ; la plupart du temps, il fait autre chose en même temps. Georges ne s’intéresse pas aux recommandations et aux actualités musicales sur Deezer : il « ne les voit pas », et de toute façon « a ses habitudes sur d’autres sites » (comme PureCharts.fr). Dans ses propres mots : « J’ai plus de mille titres sur mon iPod, mais en fait c’est toujours les mêmes que je vais écouter. C’est un peu pareil là [sur Deezer]. J’y vais pour… en fait… je veux découvrir, mais pas tant que ça je crois ».
Philippe (54 ans)
Comédien, artiste
BEP publicité
Deezer (Premium, avec forfait Orange)
« C’est l’ordinateur qui a pris le pas… c’est de la fainéantise [rires], la facilité. Le côté rapide et pratique »
Comédien professionnel, Philippe écoute de la musique tous les jours, que ce soit pour trouver l’accompagnement musical de sa prochaine production ou pour son plaisir personnel. Il écoute la musique surtout sur son ordinateur, doté d’un système de son dédié et d’un caisson de basses. Philippe possède une collection impressionnante de plusieurs centaines de disques, aux formats 33 tours, 45 tours et CD, qu’il a tous complètement arrêté d’écouter. Sa table tournante étant brisée depuis plusieurs années, il ne pourrait plus écouter ses vinyles même s’il le voulait. Il possède une chaîne haute-fidélité pour lire ses CD, mais ne l’utilise plus depuis à peu près un an parce que c’est « plus pratique » sur l’ordinateur, où tout est accessible sur YouTube et Deezer (il n’a pas pris la peine de numériser sa collection non plus). Philippe achète rarement de la musique aujourd’hui, et quand il le fait c’est un titre à la fois sur iTunes, « surtout par coup de cœur ». Abonné Deezer Premium depuis peu longtemps, il explique que les publicités récurrentes de la version gratuite le poussaient à rapidement se tourner vers sa playlist iTunes ou la radio FIP[113] (sur le Web). Très ouvert aux découvertes musicales, il a été « étonné » d’apprendre que les fiches de recommandation sur Deezer étaient personnalisées ; il a toujours cru que c’était simplement « de la pub », et n’y a jamais porté trop attention.
Nicolas (32 ans)
Vendeur
Bac +2
YouTube[114]
« Je comprends que c’est par rapport à des anciennes écoutes… C’est sûr de toute façon, ça marche avec les cookies »
Travaillant dans le secteur des ventes, Nicolas passe beaucoup de temps en voiture. Il y écoute la radio une bonne partie de la journée, « zappant en fonction des pubs ». À la maison, il écoute la musique surtout sur son ordinateur, gardé ouvert sur son bureau du matin au soir. Nicolas achète « très peu » de CD : il estime qu’il en a acheté pour environ 100 € dans la dernière année. Il « faut vraiment que ce soit des albums qui valent le coup », c’est-à-dire des albums dont au moins la moitié des titres lui plaisent. Il n’arrive pas à se souvenir de son plus récent achat par contre ; il explique qu’il écoute « beaucoup de musique », mais pour lui « ce n’est pas une passion ». Nicolas sait qu’il pourrait acheter des titres à l’unité (comme sur iTunes), mais il « a ses habitudes », et aime pouvoir écouter les CD dans sa voiture. Quand il entend une nouvelle chanson qui lui plaît à la radio, il la cherche sur Google le soir venu pour la réécouter, recherche qui aboutit le plus souvent sur YouTube. Quand la chanson termine — et même parfois avant la fin —, une nouvelle chanson attire son regard dans la colonne de vidéos recommandées à la droite de l’écran, ce qui initie « une petite heure ou deux » d’écoute, de « tout et n’importe quoi ».
Alexandre (21 ans)
Étudiant
Bac +4, master en gestion
Deezer (gratuit)
« C’est une pub de Deezer, c’est pas pour moi, ya une différence entre ça et, je sais plus, où il y a marqué “Vous aimez Cali, essayez Machin”, oui c’est une reco, j’écouterais… là non »
À 21 ans, Alexandre est le plus jeune de nos participants ; c’est aussi le seul du groupe qui utilise la fonction Flow de Deezer régulièrement, et parmi les rares répondants à se connecter au service par son identifiant Facebook. Il écoute « de 3 à 10 heures » de musique par semaine, sur l’ordinateur, en travaillant ou en faisant des tâches domestiques, et sur son iPod dans les transports. Sa sonothèque est surtout constituée de titres qu’il a téléchargés illégalement, et de quelques fichiers achetés sur Deezer (du temps où c’était possible de le faire) et sur le site de Virgin (service qui a fermé depuis). Alexandre achète tous ses titres au format numérique, et estime dépenser ainsi « même pas 30 € » par année. Lui qui avait un abonnement Deezer Premium à l’origine, compris dans son forfait Orange, il a décidé de passer à la version gratuite après avoir changé de fournisseur télécom (ce n’était plus compris dans son forfait). Il apprécie la fonction Flow, surtout pour mettre de la musique en fond. Utilisateur stratégique, Alexandre n’y laisse pas jouer les pièces qu’il n’aime pas, « sinon il va lui les refiler 30 fois ». Aussi, il a appris à recharger la page de son navigateur Web pour contourner la limite de zapping de la version gratuite de Deezer.
Résultats ⇑
Contextes d’écoute
La musique est omniprésente dans le quotidien de tous les répondants. Ils en écoutent tous les jours, surtout à la maison et dans les transports, et même au travail pour certains. Cette écoute est presque exclusivement passive. Certains participants l’expriment d’emblée, comme Céline (« pour moi c’est un fond sonore, ce n’est pas l’activité principale, je suis trop active je pense »), Julien (« parce que j’ai toujours un truc à faire ») et Alexandre (« je crois que la majorité des gens c’est comme moi, ils n’écoutent pas la musique »). Les plus mélomanes du groupe, Julie et Georges, ont d’abord indiqué avoir une écoute active « environ 20 % du temps », mais après avoir approfondi la question ont réalisé que c’était beaucoup plus rare qu’ils le pensaient. Julie, par exemple, explique que lorsqu’elle veut écouter activement un nouvel album, elle choisit des tâches qui demandent peu de concentration, comme faire la vaisselle, pour garder toute son attention sur la musique — elle fait donc tout de même quelque chose en même temps. Les moments passés dans les transports sont les plus propices à une écoute active pour la majeure partie des répondants, sur leur iPod ou la radio de leur voiture.
L’objectif principal derrière l’écoute de la musique, pour la plupart des participants, est ainsi d’avoir « quelque chose d’agréable à écouter » en fond, pendant qu’on fait autre chose (Céline). Pour certains, c’est l’émotion liée à la musique qui prime : Sébastien sélectionne les titres à écouter « selon ce qu’il ressent », « par émotion », alors que Philippe écoute certaines pièces en boucle « pour se donner un coup de punch » dans les moments difficiles. Stéphane écoute la musique pour décompresser à la maison après le travail, mais il l’écoute aussi au gym pour se motiver avec ses coéquipiers :
J’ai ma playlist sport, par exemple, voyez là, là ça va arracher. Là, on va soulever de la fonte. […] Y’a un rythme, 1, 2, 3… En finale de cette musique-là, il faut augmenter le rythme de corde. Sur un rythme comme ça, en trois minutes on fait 800 sauts à la corde.
Stéphane apprécie aussi tout particulièrement partager ses découvertes musicales, avec ses amis et sur le Web. Durant l’entretien, il ne pouvait s’empêcher de me faire écouter ses plus récentes découvertes alors qu’on explorait l’interface de Deezer. Ce goût pour le partage des découvertes est encore plus poussé chez Julie, pour qui c’est l’objectif principal de l’écoute : « découvrir, et surtout faire découvrir aux autres ».
Transformation de la consommation
C’est l’ordinateur qui est devenu l’outil privilégié pour écouter la musique chez les participants. Le plus souvent, il s’agit d’un ordinateur portable déposé sur le bureau, sans enceintes acoustiques ou équipement particulier. Céline, très équipée, écoute Deezer sur sa tablette iPad et à l’occasion sur l’application Deezer de sa télévision. Les chaînes haute-fidélité, sauf pour Georges qui y écoute encore ses CD, sont reléguées à une utilisation occasionnelle et bien ciblée, par exemple pour écouter les infos à la radio le matin. Les rares participants qui possèdent de l’équipement spécialisé comme des haut-parleurs (Julie) ou une table tournante (Georges, Philippe) admettent qu’il est hors d’usage depuis quelques années et qu’il n’a jamais été réparé. Les collections de CD prennent la poussière : on les place « à la cave » (Céline) ou dans un coffre (Julien) pour ne les sortir qu’à l’occasion, par exemple pour jouer dans la voiture (Nicolas). C’est iTunes qui devient la sonothèque principale des participants, même pour Georges qui y grave ses CD pour les jouer sur son iPod. Certains participants en sont même rendus à se débarrasser de leur équipement devenu obsolète. Sébastien, qui vient de déménager dans un nouvel appartement, en a profité pour se débarrasser de sa chaîne stéréo, lui qui possède pourtant encore quelques CD ; son MacBook Air n’ayant pas de lecteur de disque, il n’a ainsi plus aucun moyen de les lire chez lui. Julien pense sérieusement à se débarrasser de sa centaine de CD, une « perte de place », et Stéphane quant à lui est passé à l’acte, ayant mis la plus grande partie de sa collection « au recyclage ».
Les participants qui achetaient le plus de CD, Georges, Céline et Philippe, ont vu leur stratégie d’acquisition se transformer de façon différente avec l’arrivée de l’iTunes Store et des services de diffusion en continu : Georges achète toujours autant de disques, mais les choisit avec plus de discernement, alors que Philippe et Céline ont arrêté d’en acheter complètement pour se tourner plutôt vers des titres individuels sur iTunes. Chez les participants qui téléchargeaient illégalement la plus grande partie de leur musique, l’arrivée de YouTube, Spotify et Deezer a aussi eu un effet différent pour chacun : Karim et Alexandre disent avoir largement arrêté de télécharger, ayant accès gratuitement à tout ce qu’ils veulent en diffusion continue, alors que Julie télécharge plus que jamais, utilisant Deezer (de manière contournée avec Deezify) pour y télécharger gratuitement album après album.
Julie « écoute beaucoup plus de musique qu’avant », mais « achète moins parce qu’il y a des moyens de ne pas payer » ; Karim « essaie de ne pas payer pour la musique » ; Julien n’est « pas dans une démarche pour payer quoi que ce soit » ; pour Stéphane, « le but d’avoir mis Deezer sur le PC c’était de ne plus acheter de CD en fait ». Dans ces conditions, il n’est pas surprenant qu’aucun des participants ne paie directement pour son abonnement à Deezer ou Spotify ; les abonnés Premium le sont parce que c’est compris dans leur forfait de télécommunications. Alexandre, qui avait un compte Premium dans son forfait Orange, est passé à un compte Deezer gratuit depuis qu’il a changé de fournisseur. Georges, celui qui dépense le plus en pièces musicales dans le groupe, ne paie pas pour l’option Premium comme « ça ne [lui] vient même pas à l’idée de payer sur une plateforme immatérielle ».
Transformation de l’écoute
Sauf pour Céline qui venait tout juste de s’abonner à Deezer, les participants utilisent les plateformes de diffusion en continu depuis plusieurs années déjà (trois à six ans), soit depuis leur apparition à la fin des années 2000. Leur principale motivation à s’abonner au service est sa facilité d’utilisation : on apprécie « écouter de la musique d’une façon assez simple » (Karim), la « praticité » et « le côté réactif de l’outil » (Céline), « découvrir les actualités, les dernières musiques sans avoir à stocker » (Julien). Pour Julie, Deezer permet d’accéder à la musique qu’elle ne trouve pas sur YouTube. Pour Georges, c’est un « tremplin » vers l’achat ; pour Philippe, c’est le moyen de « rechercher des morceaux nostalgiques ». Les participants insistent sur la grande facilité d’utilisation et la spontanéité que permet la diffusion en continu : plus aucun disque à aller chercher, à manipuler, et on a accès gratuitement à pratiquement tout ce qu’on veut. « Le CD, il faut le mettre, il faut le changer, etc. Là, je change rien » (Stéphane) ; « Là, vous prenez n’importe quel moment de la journée, de la nuit, vous prenez n’importe quel artiste, vous l’avez, vous l’écoutez » (Céline). Selon Julien, les services comme Deezer permettent de s’ouvrir à la nouveauté, de découvrir de nouveaux artistes :
Ça élargit mes découvertes. Quand vous achetez un CD, forcément, quand vous dépensez 15 euros, vous achetez quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose que vous êtes sûr que vous allez aimer, alors qu’avec Deezer le côté pratique c’est qu’on peut écouter plein de choses différentes puisque c’est gratuit. On s’ouvre sur plus de choix je pense.
Pour Julie, dont l’écoute est largement axée sur la découverte, l’arrivée de Deezer et de YouTube a instauré un nouveau mode d’écoute, le zapping :
Je ne vais pas écouter, par exemple comme sur un CD, quand j’étais petite ; je ne vais pas écouter la musique en entier, ça va être très aléatoire, ça va être très rapide. Je vais écouter 30 secondes, je vais zapper au milieu de la chanson. Si elle ne me plaît pas je vais tout de suite… c’est une approche de la musique beaucoup plus… presque superficielle. C’est du tri, du tri, du tri, je change tout le temps, je ne vais pas prendre le temps d’écouter une musique en entier. […] Je pense que c’est la plateforme qui m’amène à faire ça. Les CD en général on va écouter la musique en entier, ou alors on va écouter presque l’intégralité, puis on zappe en se disant “ça ne m’a pas plu, je ne reviendrai pas”. Alors que là, au bout de 10 secondes, si ça ne plaît pas on peut passer à la prochaine, ou alors aller plus loin dans le morceau, etc.
Deezer et Spotify sont souvent utilisés en parallèle avec YouTube. Pour Sébastien et Georges, YouTube permet d’aller réécouter directement une chanson qu’ils ont entendue dans la journée, à la radio ou à la télévision par exemple. Le réflexe des participants est de chercher le nom du titre ou de l’artiste sur Google, et comme l’explique Nicolas, « la plupart du temps, si je vais sur Google et que je tape n’importe quel artiste, n’importe quel morceau que j’ai entendus à la radio ou à la télé, je pense que 8 ou 9 fois sur 10 le premier lien c’est un clip… sur YouTube ». Stéphane, quant à lui, écoute sa musique sur Deezer, mais retrouve ses découvertes sur YouTube pour plus facilement les partager sur le Web. En effet, l’écoute est gratuite sur Deezer, mais on doit absolument y créer un compte pour utiliser le service ; en partageant un lien YouTube plutôt que Deezer, Stéphane sait que le contenu sera accessible instantanément par tout le monde. Georges va aussi sur YouTube pour les captations de concert, le live.
Les commentaires sur les services de diffusion en continu sont généralement très positifs. On apprécie particulièrement la facilité d’utilisation, la gratuité du service et l’ampleur du catalogue de titres disponibles. Georges, qui n’avait auparavant accès qu’à des extraits sur iTunes, apprécie de pouvoir écouter les albums en entier avant de les acheter. Philippe adore retrouver sur Deezer et sur YouTube des titres qui lui seraient autrement inaccessibles : « C’est le pied, c’est le top pour certaines musiques. Surtout les musiques, style de feuilleton, de générique de film, d’émission souvenir, qui sont extraordinaires ». Les participants qui ont un abonnement gratuit à Deezer n’apprécient pas que leur écoute soit interrompue par la publicité, mais comprennent que c’est inévitable si l’accès au service est gratuit. Georges s’interroge sur le traitement que réservent les plateformes de diffusion aux artistes : « J’aimerais quelque chose où on nous dit clairement que les artistes sont rémunérés ». Julie, quant à elle, déplore l’absence de plusieurs groupes ou artistes très importants sur Deezer, comme les Beatles et Led Zeppelin[115]. Fait intéressant, c’est la seule participante à avoir noté cette absence dans le catalogue du service ; presque tous les autres disent y trouver toute la musique qu’ils cherchent[116]. Stéphane est même allé jusqu’à nier l’absence de ces groupes sur la plateforme, et ce, même après qu’une recherche n’ait donné comme résultat que des albums de reprises et des compilations.
Réseaux sociaux, vie privée et mise en scène de soi
Fait intéressant, les deux seuls participants à s’être connectés à Deezer via Facebook sont aussi les plus jeunes du groupe, Julie et Alexandre. Les autres n’y voient pas l’intérêt…
Je ne vois pas beaucoup l’intérêt, dans mon cas, d’informer les gens que je suis en train d’écouter telle et telle musique, etc. […] Je vois que c’est une information assez personnelle et privée, et peut-être assez inintéressante pour les gens [rires] pour dire, voilà. (Karim)
Parce que j’ai pas forcément envie de partager la musique que j’écoute. (Julien)
… ou sont carrément contre cette idée :
Je ne mélange jamais les comptes, c’est un principe que j’ai. (Sébastien)
Pour moi Facebook c’est du flicage, je n’ai pas envie que tout passe par Facebook. […] J’écoute de la musique, mais je ne suis pas tout le temps non plus rivé derrière mon écran, mon ordinateur… je fais plein de choses dans la vie, de vrai. J’ai pas envie tout le temps de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde avec des inconnus. (Georges)
Je trouve que c’est une violation de la vie privée. Parce que c’est trop d’information sur une seule personne, que n’importe qui peut se procurer en regardant le mur […]. Je trouve que c’est trop envahissant. (Stéphane)
Pour Julie, Facebook est « une vitrine » qui « aide au partage ». C’est un outil qui lui permet d’atteindre son objectif premier qui est de découvrir et faire découvrir de nouveaux artistes. Pour Alexandre, la connexion via Facebook ne semble pas être une décision réfléchie : il « ne regarde jamais » ce que ses amis écoutent sur Facebook, il « s’en fout ». Dans les deux cas cependant, on remarque les limites de cette connexion à Facebook dans Deezer. En effet, pour qu’un ami apparaisse sur la plateforme, il faut que lui aussi ait son compte Deezer, et même là le service ignore quels sont les amis proches et moins proches.
— Ça vous dit rien que « Anne a créé la playlist Dimanche soir », qu’elle vient de…
— Je m’en fous, je ne luis parle plus depuis trente ans. (Alexandre, 21 ans)— Fabio, entre nous, je lui ai pas parlé depuis 15 ans [rires].
— D’accord. Mais on dirait que c’est pratiquement que Fabio que vous avez…
— Oui, mais c’est bizarre, super bizarre. C’est pour ça que je trouve ça un peu, un peu étrange. Je me retrouve avec… […]. En général ils me mettent des gens que… pas ceux que j’aime plus, pas ceux avec qui j’interagis le plus, mais ceux qui écoutent le plus de musique sur Deezer. Ce n’est pas vraiment ce qui m’intéresse forcément. Je préférerais que ce soit ciblé sur les gens que j’aime. (Julie)
En ce qui concerne la collecte de données personnelles par Deezer, Julie et Karim sont du même avis, rare parmi les participants : « ça peut être utile pour bien cibler la recommandation ». Aucun des participants ne « suivait » d’autres comptes sur Deezer ou se faisait « suivre » (sauf pour les amis Facebook dans le cas de Julie et Alexandre, qui sont suivis automatiquement). Julie est la seule qui a tenté d’attirer des abonnés sur Deezer, de se mettre en scène, par exemple en créant des playlists publiques. Elle a abandonné l’idée depuis, déplorant « qu’il n’y a pas une assez grande visibilité » sur Deezer et concentrant ses efforts de réseautage sur Facebook.
La découverte musicale
La radio et la télévision sont les principales sources de découverte musicale pour la majorité des participants. Karim, Stéphane, Céline, Julien, Georges, Philippe et Nicolas placent tous la radio et la télévision comme sources de découverte principales. Comme l’explique Karim, ces participants ne vont pas nécessairement rechercher activement des nouveautés à écouter, l’information « vient toute seule » à eux, à travers les émissions qu’ils écoutent déjà. On découvre un artiste à travers des reportages télé (Karim) ou la trame sonore de certaines publicités (Stéphane) par exemple ; comme le dit Georges, « à la télé, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné ils vont être focalisés sur un artiste ». La radio, comme la télévision, occupe une place privilégiée dans le quotidien de plusieurs participants. Nicolas par exemple, étant en voiture plusieurs heures tous les jours pour son travail, la fait jouer systématiquement en fond au volant, c’est pour lui « un réflexe ». Ils écoutent aussi beaucoup la radio pour les informations : « la radio FM je vais écouter des reportages, les infos, de la musique, enfin c’est un pack » (Georges). Philippe, de son côté, apprécie tout particulièrement la chaîne FIP, qui fait jouer une grande variété de genres musicaux sans aucune publicité. Au moins trois participants, Stéphane, Céline et Philippe, ont recours à des applications de reconnaissance musicale comme Shazam et Track ID pour mettre un nom sur les titres entendus pendant la journée, à la télévision et à la radio, et les retrouver sur YouTube ou Deezer le soir venu.
La presse n’a pas la cote auprès de la plupart des participants en tant que source de découverte musicale. Pour Céline par exemple, « la musique, c’est à l’écoute », pas à l’écrit. Julien « lit assez peu » la presse, et Stéphane ne peut pas s’imaginer lire des blogues spécialisés : « Le blogue, le problème c’est que souvent, il faut lire. Moi, ça ne m’intéresse pas. Lire quelqu’un… [pfff] je trouve ça fastidieux quoi ». Julien juge peu pertinent de s’informer des critiques musicales en général :
Les critiques, moi je les lis plus sur tout ce qui est cinéma, mais pas trop sur la musique, j’aime bien me faire ma propre opinion. Parce que cinéma, si le film est mauvais, je vais passer une heure et demie à m’emmerder… si j’écoute de la musique et ça me plaît pas, je vais tout de suite changer. […] Je zappe tout de suite.
Comme pour l’achat de CD, Georges est le seul du groupe à se procurer journaux et magazines, au format papier : il trouve parfois de nouveaux artistes dans la presse écrite, « où on va faire un portrait sur un groupe, un chanteur, une chanteuse ». Alexandre dit avoir découvert récemment le magazine Les Inrocks, qu’il « lit parfois maintenant », mais exclusivement sur le Web. Julie se démarque du groupe : la lecture d’articles sur Internet est son moyen de découverte principal. Elle « épluche » ces articles « toute la journée » — il faut noter qu’en tant qu’étudiante en journalisme stagiaire dans une boîte de production, c’est aussi une tâche qui fait partie de son travail.
Les recommandations musicales affichées sur Deezer et Spotify ont un effet limité, voire nul, sur les participants. Certains, comme Georges et Karim, ne « les voient pas », et les assimilent à de la publicité. Cela vaut aussi pour les commentaires qui agrémentent ces fiches de recommandation : « Je doute un peu de la sincérité de tous les commentaires qu’on peut lire » (Georges). Selon Julien, le premier critère de sélection derrière ces recommandations est la mise en valeur des « artistes qui ont payé ». D’autres comme Philippe sont surpris quand on leur explique que les fiches de recommandation de la page d’accueil Deezer sont personnalisées. En général, les participants savent déjà ce qu’ils veulent écouter une fois rendus sur Deezer et inscrivent directement le nom d’un artiste ou d’une chanson pour faire jouer le titre de leur choix. Le seul participant à avoir pu nommer une découverte musicale faite sur Deezer est Alexandre, qui a découvert le groupe The Pirouettes en écoutant le Flow (Alexandre est aussi le seul participant à utiliser la fonction Flow en général).
Deezer : utilisation et compréhension
Tel qu’il a été mentionné précédemment, la plupart des participants savent déjà ce qu’ils veulent écouter sur Deezer avant même d’ouvrir l’interface, et s’intéressent peu aux recommandations qui y sont affichées, inscrivant directement ce qu’ils veulent écouter dans la boîte de recherche. Plusieurs facteurs expliquent ce comportement. D’abord, il faut noter que les diverses fonctionnalités de recommandation musicale sur les plateformes de diffusion en continu — par exemple, le Flow et les fiches de recommandation sur Deezer — sont encore très récentes, et que les habitudes d’écoute des participants semblent déjà bien ancrées. Les participants découvrent la musique surtout à la radio et à la télévision, de manière passive ; comme le dit Georges, ils ont déjà leurs habitudes ailleurs :
Je me rends compte que j’ai plein d’usages pour plein de choses et qu’on pourrait peut-être les regrouper en un. Mais, il y a des moments pour écouter la radio, dans ma journée. […] Il y a des moments où je regarde la télé, il y a un truc, une émission, il y a des moments pour lire la presse ; voilà, en fait, tout est un peu cloisonné. C’est différentes utilisations, différents usages… encore une fois je ne passe pas mon temps devant un écran d’ordinateur.
Ensuite, l’interface de Deezer suscite une grande confusion chez les participants. Les modalités d’utilisation et l’interface changent fréquemment, et plusieurs répondants semblent agir sur la plateforme selon des modalités qui ont changé depuis, par exemple la limite du temps d’écoute pour les comptes gratuits, qui est passée de 5 à 10 heures par mois puis a été abolie (Julie, Stéphane, Georges), et l’achat de titres musicaux, supprimé du service lui aussi (Philippe). On comprend mal la provenance des recommandations et le raisonnement qui les motive :
— Ça fait deux mois que je n’ai pas utilisé cette page-là [À écouter]. En fait, en général ils marquent… là je ne sais pas pourquoi ils ne marquent pas… mais ils disent en général « Vous avez écouté tel groupe, vous devriez aimer celui-ci ». Mais là ils ne le marquent pas. Ou alors c’est conseillé par… qu’est-ce que c’est que ce truc-là, « Deezer partner », je sais pas.
— Et ça ici, c’est quoi ?
— Je sais pas.
— Cette fiche-là en particulier.
— « Radio conseillée par Sam ». Je ne connais pas Sam, je ne sais pas qui est Sam, c’est peut-être quelqu’un qui me suit.
— C’est écrit qu’il est « Deezer Editor », c’est quoi ça ?
— Je ne sais pas. Franchement, j’en sais fichtre rien. […]Pour moi c’est un flou total la recommandation. J’y vais, j’écoute, je fais confiance, mais je sais pas de qui ça vient. (Julie)
D’autres participants ne font pas confiance aux recommandations, les considérant avant tout comme de la publicité (Karim, Julien, Alexandre). Julien en particulier doute de la fiabilité des recommandations Deezer en raison de ses mauvaises expériences sur d’autres plateformes de diffusion :
J’ai des doutes sur la fiabilité de ça [le Flow], c’est peut-être pour ça que je suis un peu réfractaire. […] Parce que je crois qu’il y a d’autres supports qui fonctionnent comme ça, autres que musicaux, par exemple, télé en replay, sous mode « Vous avez aimé ça, vous devriez aimer cela », etc. Et finalement, parfois je me rends compte que pas du tout, c’est complètement à côté de la plaque.
Julie, Stéphane et Céline créent des playlists sur Deezer, pour pouvoir retrouver facilement leurs titres favoris, écouter leur musique chez des amis lors de soirées (en ouvrant leur compte sur l’ordinateur de leur hôte) ou encore se motiver en faisant du sport avec certains titres précis. Karim, Julien, Philippe, Georges et Alexandre, au contraire, n’enregistrent ni favoris ni playlists sur leur compte Deezer. Ils se contentent de chercher ce qu’ils veulent écouter au fur et à mesure, selon leur envie du moment. Karim explique que ses goûts changent ; Julien, que « si ma mémoire flanche, c’est que je n’avais pas si envie que ça de le réécouter » ; Georges, que ses titres favoris, de toute façon, il les achète sous forme de CD.
Notre entretien a été l’occasion pour les participants de découvrir la fonction Flow : sauf Alexandre, aucun ne l’avait utilisée auparavant. Julie et Georges se sont montrés critiques par rapport aux recommandations qu’ils y ont vues :
Ce que Deezer me recommande, quand c’est eux qui me proposent ça via Flow, c’est que des musiques que je connais déjà, donc ça ne me recommande rien du tout. Ça se base peut-être sur mes playlists, je ne sais pas, c’est que des trucs que je connais déjà. (Julie)
Oui, ça peut être sympa, mais après je ne connais pas les tenants et aboutissants, donc je ne sais pas comment il me fait cette sélection-là. Il prend des décisions, on est content, pas content… […] Je sais pas, parce que pour moi ça ne répond pas à un besoin, j’avais pas de besoin vis-à-vis de ça. (Georges)
D’autres, comme Céline et Julien, se disent ouverts à l’idée d’utiliser le Flow maintenant qu’ils en comprennent le fonctionnement (après mes explications) :
Flow, déjà, c’est un terme anglo-saxon, derrière je voyais pas le service qu’ils proposent en fait. J’avais pas idée que c’était quelque chose d’assez personnalisé. On ne sait pas la part d’aléatoire dans les choix qu’il nous fait. Maintenant que je connais un peu mieux, oui [je pourrais l’utiliser]. (Julien)
Les fiches de recommandation de l’onglet À écouter, parce qu’elles s’affichent par défaut à l’ouverture de Deezer (et sans qu’on ait à cliquer sur quoi que ce soit, contrairement au Flow), sont plus familières aux participants. Stéphane les consulte à l’occasion, mais surtout pour se renseigner sur les sorties d’albums des artistes qu’il connaît et apprécie déjà : « j’y vais juste pour les nouveautés en fait ». Julien, de son côté, dit ne carrément jamais écouter d’artistes qu’il ne connaît pas déjà sur Deezer : « De tomber là [la page À écouter] sur un disque… d’écouter un artiste que je ne connais pas, même pas de nom, sans avoir jamais entendu une de ses chansons auparavant ? Ah non !». On remarque que ce sont surtout les illustrations liées aux recommandations qui attirent l’œil des participants et qui les incitent, ou pas, à écouter un artiste inconnu :
— [À propos d’une fiche de recommandation] Est-ce que ça vous intéresse d’écouter ça ?
— L’image en elle-même ne m’intrigue pas plus que ça. Après, si… j’ai la curiosité, maintenant je sais que c’est en fonction de mes goûts, ouais, je vais aller découvrir. Après, l’image en elle-même ne m’attire pas plus que ça.
— Alors ce que vous voyez en premier, c’est l’image.
— Ouais.
— Et est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que c’est écrit ici « Conseillé par Arpad, Deezer Editor » ?
— J’ai vu, mais c’est d’abord l’image qui sort, avec le fait qu’on puisse l’écouter, par le symbole Play quoi. Oui oui, j’ai vu qu’il y avait l’icône avec l’image d’une reco et le nom, mais après… (Céline)— [À propos d’une fiche de recommandation] Ça ne me dit pas. Et je ne vois pas en quoi c’est en rapport avec ce que j’écoute en fait.
— Vous connaissez le groupe Petrol ?
— Non, pas du tout.
— Si vous ne connaissez pas, comment faites-vous pour savoir que ça ne correspond pas à vos goûts ?
— Bon voilà, je ne vais pas l’écouter parce que je connais pas, enfin, juste l’image… ça ne me donne pas envie d’écouter. Je ne vois pas en quoi c’est relié avec mes musiques quoi.
— Juste par l’image, vous allez dire, non…
— Oui, je sais pas… marqué par Deezer… c’est pas parce que Deezer dit que c’est bien que c’est bien. Je ne vais pas m’amuser à aller écouter tous les trucs qu’il me propose. (Alexandre)
Le type de recommandation qui semble le plus apprécié par les participants, sur la page À écouter et dans l’interface en général, est celui qui est présenté selon la formule « Vous aimez ___, essayez ___ ». Cliquer sur le nom d’artistes inconnus dans la section « Musique similaire » de l’interface Spotify est la principale manière dont Karim dit découvrir de nouveaux artistes sur cette plateforme. Pour Céline, cette fonctionnalité est parmi ses caractéristiques préférées de Deezer :
À l’époque à la FNAC, quand vous achetiez vos CD, voilà c’était par styles musicaux. Vous aviez les lettres, vous cherchiez un artiste, y’avait une jaquette derrière d’un autre artiste, ça vous parlait, vous pouviez le prendre, tiens. Après, fallait l’acheter, allez l’essayer, ou encore l’écouter avec les casques. Mais voilà, là c’est beaucoup plus facile, quand vous allez sur « Artistes similaires », d’écouter, ça vous engage à rien. Vous aimez, super vous avez fait une découverte, vous n’aimez pas, voilà, ça vous a pris… x secondes ou minutes de votre temps. Ça c’est vachement bien je trouve, qu’on n’avait pas avant.
Julie et Alexandre ont remarqué une transformation récente dans l’interface de Deezer, qui fait en sorte qu’on leur affiche moins de recommandations selon les artistes similaires ou encore l’historique d’écoute. À leur avis, c’est un changement malheureux. Alexandre dit en avoir compris que la page d’accueil n’était tout simplement plus personnalisée :
— Là c’est des trucs qu’ils sélectionnent eux, avant c’était adapté à nous, alors que maintenant, pas du tout, enfin j’ai l’impression en tout ça.
— Que c’est moins adapté à vous maintenant ?
— Oui, avant c’était « Sélectionné pour vous », je me souviens, ça m’avait marqué. Maintenant, c’est des trucs à eux, qu’ils écoutent eux, enfin qu’ils sélectionnent eux, je veux dire.
— Avez-vous vu une différence dans le style de musique qui vous était recommandé ?
— Oui, je sais pas, avant c’était assez proche des artistes que j’écoutais, alors que là pas du tout.
Une autre fonctionnalité très appréciée par les participants est la section Top titres de la page de profil des artistes, qui affiche, comme le nom le dit, les cinq titres les plus joués de cet artiste sur la plateforme.
— [À propos d’une recherche sur Stevie Wonder] Et donc j’ai commencé à regarder ça, puis j’ai regardé 2014-2015, tooooute une quantité d’albums…
— Ça c’est la liste de tous les albums ?
— Oui, et que pour 2014 en plus ! Ça m’a énervé, et en plus c’est des titres que je connaissais pas. Et voilà, il y a le top titres. Donc j’ai commencé à lancer les top titres. Puis j’ai écouté les 5 chansons puis je suis revenu en écouter quelques-unes que j’avais bien aimées.
— Est-ce que ça arrive souvent avec vos recherches, que vous finissez par simplement écouter des top titres ?
— Oui. Parce que justement, il y a beaucoup de choses, de remix, ou alors la version karaoké, des choses pas intéressantes… Comme je suis un peu perdu, au bout d’un moment, je me concentre sur l’essentiel, sur le best of quoi. (Julien)
Cette fonctionnalité permet à la majorité des participants qui choisit quoi écouter sur Deezer d’après ce qui joue à la télévision et à la radio de trouver rapidement ce qu’elle cherche, à savoir les « tubes » familiers qui y ont joué.
Les onglets Explorer, Top Écoutes, Radios et Applications sont rarement visités par les participants. À l’exception de Stéphane et de Philippe, qui disent jeter un œil à la page Top Écoutes de temps en temps pour « voir les nouveautés », les participants restent sur la page d’accueil ou vont directement à la boîte de recherche.
Il y a déjà tellement de trucs sur la page d’accueil, j’ai pas le temps de faire les autres onglets. La page d’accueil en plus elle ne s’arrête jamais, aussi loin qu’on puisse descendre ça ne s’arrêtera jamais, c’est comme Facebook… j’ai déjà suffisamment avec la page d’accueil. […]Ya trop de trucs c’est impossible, on ne peut pas s’y retrouver. Là on est dans À Explorer ? Mais en fait c’est la même chose que l’accueil… […] Ça a l’air pas mal, mais trop de trucs, sérieusement, on peut passer… non, non… sur la page d’accueil déjà y’a tout ça en… plus concis. (Julie)
Stéphane et Céline n’ont « pas le réflexe » d’écouter des Radios Deezer ; Julien et Georges ont « leurs habitudes » ailleurs, pour écouter la radio et s’informer des nouvelles sorties. Alexandre, quant à lui, est confus par rapport au concept même des Radios Deezer :
Chaque fois ça me saoule, ça me met… Je ne comprends pas leur concept. Il y a une radio par rapport à un artiste, ça passe la musique d’autres artistes. J’ai jamais trop compris pourquoi ils appelaient ça « radio ».[117]
Personne n’utilise l’onglet Applications.
Les participants qui utilisent leur téléphone intelligent pour écouter Deezer sont rares ; la plupart le font avant tout sur ordinateur. Stéphane écoute ses playlists sur son téléphone au gym et dans les transports, en attendant le bus par exemple. Céline, qui écoute aussi Deezer sur sa tablette et à la télévision, écoute elle aussi ses playlists au gym. Elle dit voir la fonction Flow et les fiches de recommandation sur son téléphone, mais ne pas avoir le temps de découvrir de la musique à ce moment-là. Son appareil principal pour écouter Deezer est sa tablette iPad. Écouter une playlist semble être le moyen pour ces deux participants de limiter au minimum l’interaction avec l’appareil pendant l’activité sportive ; comme le dit Stéphane, sortir le téléphone pour changer une pièce qu’on n’aime pas « c’est chiant ». Beaucoup de participants possèdent un téléphone intelligent sur lequel ils pourraient écouter Deezer, mais ne le font pas pour toutes sortes de raisons : il n’y a pas assez de place sur le téléphone (Julie), en métro ça risque de ne pas capter (Julien), les limites imposées aux comptes gratuits sur l’application mobile (Alexandre), un désir de « différencier les choses » (Georges). Les participants préfèrent en général écouter leur musique sur un iPod.
Discussion ⇑
Les caractéristiques de la nubémorphose
Les transformations de l’écoute et de la consommation musicale au gré des innovations de format, décrites par Hennion, Granjon et Combes à propos du CD et du fichier, se poursuivent aujourd’hui avec la diffusion en continu. Le premier facteur d’importance pour la découverte musicale, autant chez Hennion que chez Granjon et Combes, est la socialisation culturelle : ce sont les réseaux relationnels qui sont les principaux relais des pratiques musicales, autant pour les amateurs « profanes » que pour les « experts ». Granjon et Combes observent chez leurs répondants l’échange de contenus musicaux « au gré des rencontres », par l’entremise de lecteurs MP3 et de clés USB ; selon leurs chiffres, un Français sur deux déclare se faire prêter ou échanger régulièrement de la musique, et 82 % des moins de 25 ans le font. Laplante observe chez ses répondants que les amis, les collègues et la famille sont « de loin la source de découvertes musicales la plus importante », par exemple à l’occasion d’échanges de CD ou de séances de magasinage en groupe. Cela concorde avec les conclusions répétées de nombreuses études en sciences de l’information. Laplante le note dans sa thèse, ces études démontrent systématiquement que la recherche et l’écoute de musique sont des activités éminemment sociales[118]. Ce phénomène a été observé à l’égard du magasinage en groupe (Cunningham, Reeves et Britland, 2003[119]), de l’écoute chez les amis (Lee et Downie, 2004[120]), de la navigation dans les collections des autres utilisateurs sur Kazaa (Taheri‐Panah et MacFarlane, 2004[121]) et du partage des collections musicales entre colocataires et membres d’une même famille (Cunningham, Jones, et Jones, 2004[122]). Il a donc été très surprenant de constater à quel point le réseau social avait peu d’importance pour la découverte musicale chez les répondants de notre étude.
Aucun des participants n’a nommé son réseau social comme source première de découverte musicale. Le réseau social a été classé en troisième position par la majorité des participants, derrière la radio et la télévision. Pour Julie et Alexandre, les plus jeunes du groupe, ce sont les articles sur le Web, plutôt que la radio et la télévision, qui occupent la première position du classement des sources de découverte. Pour Céline, abonnée à Deezer depuis seulement un an, c’est Deezer qui est en première position, suivi de la radio, de la télévision, puis enfin du réseau social. Les participants ont souvent mentionné pendant leur entretien quelques anecdotes quant à l’aspect social de leurs expériences musicales — découverte récente d’un groupe grâce à un ami (Julie), partage des découvertes musicales en tant que DJ dans des soirées dansantes (Stéphane), discussions avec leur mari ou épouse (Céline, Philippe, Stéphane) —, mais ils placent systématiquement le réseau social en deuxième, troisième ou quatrième position quand on leur demande de classer leurs moyens de découvrir la musique. L’échange de disques et de fichiers musicaux, décrit comme une pratique courante pour plus de la moitié des Français en 2007 par Granjon et Combes, est complètement absent chez nos participants. Sauf Julie et Alexandre, aucun participant ne s’était connecté à Deezer par son identifiant Facebook. Les commentaires à propos de ce service de réseautage Web sont assez négatifs, et les participants précisent qu’ils préfèrent de loin discuter de leurs découvertes en personne :
Je vais avoir le réflexe, si j’aime bien quelque chose, de le dire en visu à des amis, et pas d’aller taguer… de leur recommander sur des plateformes comme ça. (Céline)
Si je veux vraiment suivre quelqu’un, je l’appelle, je me connecte différemment, autre que Facebook. (Sébastien)
J’ai pas envie de partager avec tout le monde. Je peux partager avec mes amis, mais en vrai. (Georges)
Plusieurs commentaires négatifs ont aussi fait surface à propos de la découverte par les amis en général. Sébastien, qui a plusieurs amis qui travaillent comme DJ, dit ne pas leur parler de musique malgré leur expertise parce qu’« ils sont restés sur la même tendance musicale ». Georges place ses amis en dernière position de son classement des recommandations musicales :
On essaie toujours d’influencer le goût de nos amis. J’adore, j’adore… des fois on fait un flop, je… c’est plus difficile les amis je trouve. […] On est tous figés dans nos artistes, nos… notre musique en général. Et puis souvent on fait plaisir à l’autre, c’est peut-être pas mal, mais je crois, on sait intimement que forcément ça va peut-être pas nous plaire, ou forcément ça nous plaît, on le sait déjà. C’est plus hermétique je trouve les amis.
Pour Karim, « les goûts musicaux, c’est assez personnel ». Il « ne voit pas l’intérêt » d’aller voir ce que ses amis écoutent, sur Facebook ou ailleurs : « ce n’est pas ce que mes amis écoutent qui m’intéresse, c’est vraiment, c’est quoi les tendances en général ». Alexandre quant à lui précise que si les recommandations musicales de ses amis peuvent être pertinentes, elles ne le sont pas toujours : « les amis ça dépend, je sais très bien qu’il y en a qui écoutent des trucs horribles, enfin, que je n’écouterais jamais. Ça dépend de la personne quoi ».
Les recommandations musicales personnalisées de Deezer sont comparées avantageusement à celles des amis proches par certains participants :
— Le fait que ce soit un humain, Sam [un « Deezer Editor »] par exemple, plutôt que euh… la formule Deezer, qui a jugé que tel artiste était dans tel genre, donc vous allez aimer tel autre artiste…
— Je préfère cette technique-là plutôt que conseillé par quelqu’un qui… c’est horrible, mais qui va moins connaître mes goûts qu’une machine, qu’un site automatique qui… qui a déjà enregistré toutes mes données, je vais lui faire plus confiance, à la plateforme Deezer, qu’à des gens en particulier.
— Et pourtant c’est important pour vous quand même le rapport humain, Facebook, tout ça.
— Ouais, donc… parce que je ne les connais pas ces gens.
— Par rapport à… disons si on fait une autre comparaison… vos amis qui vous connaissent, versus la plateforme qui connaît vos goûts, vous faites confiance à qui le plus ?
— Mmm, les deux autant, les deux autant.
— D’accord.
— Ouais. Il y en a qui me connaissent en tant qu’humain, mais la machine en même temps connaît beaucoup plus… beaucoup plus les musiques que j’écoute que mes amis. En même temps, mes amis connaissent mon caractère. Les deux vont se valoir. (Julie)C’est variable. Je pense oui, une recommandation d’une personne, ç’a un plus fort impact qu’une chanson dans le Flow. Après en même temps, le Flow du coup est imposé, on ne la choisit pas, alors du coup on va l’écouter. Alors qu’un ami me parle d’une chanson, je n’ai pas forcément le réflexe, je vais oublier de regarder. Alors que dans le Flow, elle s’affiche toute seule, on ne choisit pas de la voir ou pas. Pas besoin de cliquer dessus. (Alexandre)
On observe que plusieurs éléments de l’écoute et de la découverte de musique qui étaient liés au social ont disparu avec la diffusion en continu sur des plateformes telles que YouTube, Spotify et Deezer. L’achat de CD, sauf pour Georges, est chose du passé chez mes participants. Les collections de disques, chez ceux qui en ont déjà possédé une, sont délaissées et accumulent la poussière ; les plus proactifs du groupe ont déjà commencé à s’en débarrasser. Les collections de fichiers musicaux sont toujours utilisées, notamment pour alimenter les lecteurs iPod qui sont encore très populaires, mais les participants y ont de moins en moins recours depuis qu’ils peuvent écouter ce qu’ils veulent sur demande et sans avoir recours aux plateformes de téléchargement illégales. En fait, la moitié des participants ont complètement renoncé à enregistrer quelque titre, album ou playlist que ce soit sur Deezer et Spotify ; leur utilisation est limitée à la boîte de recherche. Sans disques à magasiner en groupe, sans objet à échanger ou à partager, sans collection musicale, même numérique, dans laquelle naviguer, les conditions d’échange et de partage de musique se sont radicalement transformées avec l’avènement de la diffusion en continu. L’« énorme recours au réseau des proches » observé par Hennion dans Figures de l’Amateur, qui « permet de contourner l’opacité de l’objet disque »[123], perd beaucoup d’importance à l’ère de la diffusion en continu, où tout compte fait n’importe quel titre peut être écouté sur demande, gratuitement. Comme l’a dit Julien, nos participants « aiment bien se faire leur propre opinion » en allant écouter la musique directement sur YouTube, Deezer ou Spotify.
Pour ceux qui choisissent de ne rien indiquer en favori sur Deezer, qui entrent chaque fois le nom du titre ou de l’artiste recherché au gré de leurs envies, aucune collection, aucune trace de l’écoute ne subsiste – sauf dans les bases de données privées des plateformes concernées, ici Google, Deezer et Echo Nest. Morris nomme ces nouveaux prescripteurs culturels numériques « infomédiaires » (infomediaries). Ce sont « les entités organisationnelles qui surveillent, collectent, traitent et réorganisent les données culturelles et techniques au sein d’une infrastructure informationnelle qui façonne la présentation et la représentation des biens culturels[124] ». Ces services, qui « manipulent, classent et lient entre elles les données d’une manière qui étend grandement les capacités humaines », « traitent les biens culturels en tant que logiciels, comme un code informatique sur la base duquel d’autres lignes de code peuvent s’ajouter et d’autres programmes peuvent être construits[125] ». Les infomédiaires « étendent les capacités des biens culturels numériques […] à travers une collecte de données personnelles à la fois continue et généralisée[126] ». La « cohérence dans l’assemblage des œuvres » et l’« appropriation plus intime et personnalisée »[127] décrites par Hennion au sujet du format CD, ainsi que l’écoute par playlist décrite par Granjon et Combes au sujet du format musical numérique, qui « offre la possibilité aux amateurs de conformer au mieux leurs programmations musicales à leurs états émotionnels[128] », continuent à se transformer avec Deezer et Spotify et à tendre vers une personnalisation toujours plus poussée, maintenant automatisée. Sur ces plateformes numériques, explique Morris, « l’interaction même avec les biens culturels en vient à alimenter une boucle récursive (recursive loop) de recommandations culturelles futures[129] ».
La collecte de données personnelles au cœur de ce nouveau système de recommandation en constitue non seulement l’assise informationnelle, mais également la fondation financière. Les « solutions innovantes de monétisation des contenus » décrites par Granjon et Combes en 2007 comme « encore assez largement à l’état d’expérimentation [130]» ne se sont jamais établies avec succès ; c’est le modèle de la « gratuité » — caractérisé par l’affichage de publicités et la collecte continue de données personnelles — qui est devenu la norme. La captation des audiences, le référencement et la prescription, présentés par Granjon et Combes comme des avenues de financement alternatives « portées par des acteurs marginaux »[131] de l’industrie musicale, en sont devenus le moteur économique principal ; en témoigne Echo Nest dont dépendent aujourd’hui plusieurs centaines de services et d’applications.
Personne parmi les participants à l’étude ne paie directement pour son abonnement Deezer ou Spotify. Les abonnés à la version Premium de Deezer le sont grâce à leur forfait de télécommunication qui l’inclut d’emblée. C’est d’ailleurs en bonne partie ce partenariat avec Orange qui a soutenu la croissance de Deezer en France : il a fait passer le nombre d’abonnements Premium d’à peine 20 000 à 1 million en l’espace d’un an seulement[132]. Les participants refusent de payer quoi que ce soit pour la musique en diffusion continue ; parce qu’ils refusent de payer pour écouter de la musique en général maintenant qu’il y a « des moyens de ne pas payer », ou qu’il leur faut absolument obtenir un bien tangible en échange, par exemple Georges avec ses CD et Julie avec les vinyles qu’elle achète à l’occasion. Les rares participants qui dépensent de manière significative pour la musique le font pour assister à des concerts, par exemple Julie et les 400 € et plus qu’elle peut dépenser par année pour assister à des festivals. La discomorphose d’Hennion, après avoir « fait glisser l’appréhension de la musique classique comme un ensemble d’œuvres à un ensemble d’enregistrements » et « fait passer au second plan [la] performance publique en temps réel »[133], se voit renversée à son tour alors que l’accès instantané aux plateformes numériques et l’écoute parfois erratique qui les caractérise soulignent comme par contraste la richesse de l’expérience live, qui devient ainsi la principale dépense des mélomanes comme Julie.
Malgré ces transformations dans l’écoute, le partage et la commercialisation de la musique avec la diffusion en continu, on note dans l’ensemble que les changements s’effectuent lentement, en continuité avec les habitudes d’écoute et de consommation qui caractérisent le CD et le fichier. Comme l’ont dit Granjon et Combes à propos de la discomorphose d’Hennion[134], on observe chez les participants que les cadres de la discomorphose et de la numérimorphose, loin d’être obsolètes, sont « encore très largement à l’œuvre ». Les « relais médiatiques » que sont la radio et la télévision ont encore une grande influence chez les participants ; c’est là qu’ils disent effectuer la plus grande partie de leurs découvertes musicales. Comme avec les « repères visuels » observés par Hennion au Virgin Megastore, c’est encore aujourd’hui beaucoup par l’aspect visuel qu’on appréhende la musique sur Deezer et Spotify. Les participants le disent, c’est ultimement l’image qui accompagne la fiche de recommandation sur la page d’accueil qui détermine si on s’y intéresse ou non. La fonction Flow de Deezer, qui pousse la recommandation sans que l’utilisateur ait à cliquer sur quoi que ce soit, diminuera peut-être l’emprise de l’image, mais elle est encore très peu utilisée chez les participants.
Les conclusions de la thèse de Laplante sont encore vraies sept ans plus tard chez les participants : la découverte musicale se fait chez eux surtout de manière passive, et le furetage demeure une pratique de recherche généralisée et très appréciée. Les fonctionnalités de recommandation et de découverte sur Deezer sont encore très peu utilisées par les participants. Chez la plupart d’entre eux, l’utilisation est limitée à la boîte de recherche, comme si Deezer n’était rien de plus qu’une sonothèque iTunes gratuite de 30 millions de titres. Les recommandations musicales sont abordées avec méfiance, et plusieurs les considèrent comme de la publicité, ou doutent qu’elles soient personnalisées. Même en page d’accueil, elles leur sont invisibles, ils ne les « voient pas ». Cela dit, cette continuité dans les pratiques musicales ne s’observe pas chez les deux plus jeunes participants de notre échantillon, Julie et Alexandre. Comme dans l’enquête de Donnat sur Les Pratiques Culturelles des Français 2008, « nombreux sont les indices qui laissent entrevoir la profondeur du changement en cours quand on quitte le niveau général pour s’intéresser aux comportements des jeunes générations »[135]. En effet, Julie et Alexandre sont les seuls participants chez qui la radio et la télévision ne jouent pas un rôle prépondérant, ces derniers préférant les articles Web pour découvrir de nouveaux artistes. Ce sont également les seuls à s’être connectés à Deezer par leur identifiant Facebook ; ils ne partagent pas les grandes inquiétudes liées à la protection de la vie privée des autres participants. Julie décrit la recommandation Deezer comme équivalente à celle d’un ami proche, et Alexandre est le seul du groupe à utiliser la fonction Flow — il a même déjà découvert des groupes musicaux grâce à cette nouvelle fonctionnalité[136]. Notre enquête, qualitative et exploratoire, n’est pas statistiquement représentative, il faut le rappeler. Malgré tout, ces observations laissent entrevoir de grandes transformations à venir dans les pratiques musicales et culturelles en général, qui méritent d’être étudiées plus en profondeur. Il sera intéressant de lire les conclusions de la prochaine enquête sur Les Pratiques Culturelles des Français pour obtenir un portrait représentatif de cette évolution.
En résumé, la nubémorphose telle qu’observée chez nos participants se caractérise par :
- L’individualisation des pratiques musicales, alors que la disparition conjointe de l’objet musical — disque et fichier — et de la collection transforme les pratiques de partage pourtant bien établies, et que « l’opacité de l’objet disque » fait place à la transparence et à l’instantanéité de la diffusion en continu.
- La montée en influence des « infomédiaires », ici Echo Nest et Google, qui collectent, traitent et réorganisent les données culturelles et se positionnent au cœur de la nouvelle industrie musicale.
- L’accès instantané et gratuit aux contenus musicaux, financé par la publicité, les partenariats avec les entreprises de télécommunications et la collecte de données personnelles, et qui établit les spectacles et les festivals comme la principale dépense des nouveaux mélomanes.
- Une continuité dans les cadres de la discomorphose et de la numérimorphose, mais qui laisse entrevoir de grandes transformations à venir quand on s’intéresse aux utilisateurs plus jeunes, beaucoup plus ouverts aux nouveaux outils de recommandation automatisés.
Conclusion ⇑
Nous avons atteint un point tournant dans les pratiques culturelles, tout particulièrement les pratiques musicales. Suivant le CD puis le fichier musical, ce sont aujourd’hui les plateformes de diffusion en continu comme YouTube, Deezer et Spotify qui alimentent l’écoute semi-permanente, à toute heure et en tout lieu, des amateurs. Alors que les biens culturels se transforment progressivement en services culturels, c’est l’industrie musicale entière qui se repositionne autour d’une nouvelle infrastructure basée sur l’analyse des mégadonnées et la prescription automatisée des nouveaux « infomédiaires » comme Echo Nest et Google. L’accès à la musique est soudainement instantané et gratuit, et cette accessibilité nouvelle transforme rapidement les pratiques des amateurs. L’ordinateur est maintenant si central pour l’écoute de musique qu’on laisse le reste de l’équipement à l’abandon. Sauf pour quelques irréductibles mélomanes, les collections musicales, physiques et numériques, sont elles aussi délaissées ; plusieurs se contentent de chercher titres et artistes au gré des envies, sans jamais enregistrer de favoris. On délègue ainsi le travail d’organisation de la musique aux nouvelles plateformes de diffusion. Cette nouvelle accessibilité transforme également les pratiques d’échange et de prescription, alors que l’opacité de l’objet disque fait place à l’écoute instantanée où l’amateur se fait sa propre idée, et que les objets ou fichiers musicaux autour desquels s’articulait une grande variété de pratiques sociales tombent en désuétude. La relation intime de l’amateur à la musique amorcée avec le disque, puis accentuée avec le tournant numérique par la déconstruction des albums en playlists personnalisées, s’intensifie encore davantage tandis que cette personnalisation s’alimente grâce à une collecte de données personnelles continuelle et devient automatisée. Les participants de l’étude découvrent la musique encore largement par les relais médiatiques traditionnels, soit la radio et la télévision, et affichent une réaction d’indifférence, voire de méfiance, face aux nouveaux outils de recommandation de Deezer et de Spotify. Cela dit, on observe chez les participants plus jeunes une plus grande ouverture envers ces outils automatisés, qui laisse entrevoir la montée en influence des activités de prescription des nouvelles plateformes de diffusion musicale en continu dans un avenir rapproché.
L’avenir de la diffusion musicale en continu
L’article The Zero Button Music Player de Paul Lamere[137], directeur de la plateforme pour concepteurs chez Echo Nest, donne déjà un aperçu des innovations à venir pour Spotify. Publié sur son blogue personnel, l’article présente le projet Zero UI démarré en janvier 2014, qui vise à réduire au minimum l’interaction entre utilisateur et application, et à attirer ainsi sur la plateforme même les auditeurs les plus indifférents. Aider les auditeurs à choisir leur musique toujours plus facilement est primordial pour Spotify, explique-t-il, quand on sait que la plupart d’entre eux sont au mieux des auditeurs occasionnels. Lamere s’appuie ici sur une enquête menée par l’agence publicitaire Emap en 2006 au sujet des pratiques musicales de 2200 Britanniques de 15 à 39 ans[138], et qui les divise en quatre catégories selon leur intérêt pour la musique : les « Savants » (7 % des participants), les « Enthousiastes » (21 %), les « Occasionnels » (32 %) et les « Indifférents » (40 %). Ces quatre groupes, explique Lamere, dépensent de manière très différente pour la musique. Alors que les Savants sont prêts à dépenser plus de 1000 $ par année pour la musique, les Indifférents refusent de payer quoi que ce soit. C’est pour attirer ce groupe d’utilisateurs potentiels en particulier, qui représenterait quand même près de la moitié de la population, que l’accès gratuit est devenu la norme dans l’industrie selon Lamere. Cela dit, les auditeurs Indifférents ne refusent pas seulement de payer ; ils ont une tolérance particulièrement basse pour tout temps d’attente ou effort à fournir pour écouter la musique qu’ils désirent. L’objectif de Lamere avec son projet Zero UI est, comme le nom le dit, de réduire l’interaction avec Spotify à zéro pour séduire ces utilisateurs potentiels, de « franchir cette dernière barrière qu’est le bouton Play entre l’auditeur et la musique ».

Figure 9 – Les quatre types d’auditeurs selon l’enquête Emap (The Zero Button Music Player)
L’application Zero UI, en se basant non seulement sur les signaux implicites d’utilisation comme l’historique d’écoute et de zapping, mais également sur les données personnelles et contextuelles liées au téléphone intelligent hôte — emplacement géographique, horaire personnel, météo, etc. —, sélectionne la pièce musicale idéale à jouer en toutes circonstances, sans que l’utilisateur n’ait à appuyer sur aucun bouton. Par exemple, l’application sait que l’utilisateur sort le matin à 7 h pour faire son jogging, et lance automatiquement un titre rock rythmé.
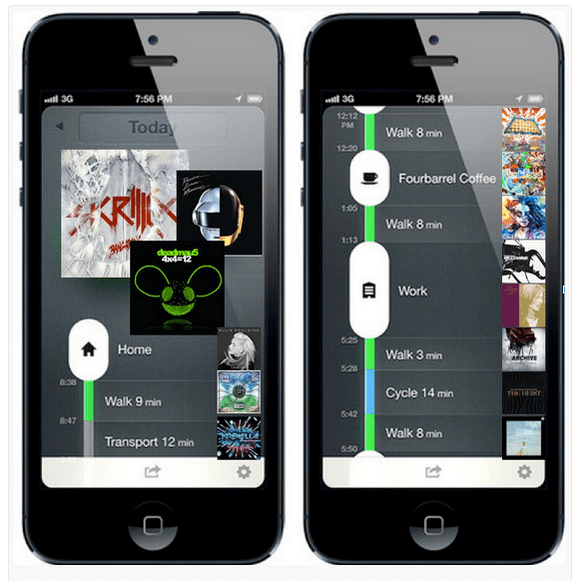
Figure 10 – Esquisse de l’interface Zero UI (The Zero Button Music Player)
Si l’avenir de la diffusion en continu semble être orienté vers la contextualisation et la personnalisation de l’écoute sur application mobile, les innovations comme Zero UI risquent toutefois de se développer de manière très graduelle. En effet, les nouvelles conditions d’utilisation de Spotify rendues publiques en août 2015, sans doute liées aux efforts de personnalisation de la compagnie, ont soulevé la controverse parmi beaucoup d’utilisateurs et de journalistes, mécontents que la plateforme demande un accès élargi aux données personnelles pour son application mobile[139]. La grogne était telle que le directeur général de Spotify a publié la même semaine un message d’excuse à ses utilisateurs, spécifiant que l’accès à ces nouvelles données personnelles « ne se ferait que pour des usages spécifiques, en vue de personnaliser l’expérience Spotify »[140]. On a vu pour l’instant ces permissions d’accès logiciel utilisées dans la nouvelle fonctionnalité « Running » de l’application mobile Spotify, qui collecte les données du GPS et des capteurs de mouvement du téléphone pour accorder le tempo de la musique à celle de la course.
La sociologie culturelle en mouvement
Au moment où la musique est plus accessible que jamais, que son écoute est désormais parmi les pratiques culturelles les plus prisées et les plus courantes, c’est un atout de cette étude que de s’être intéressé à des amateurs occasionnels. Sélectionner les participants parmi ceux d’une autre étude, sans lien direct avec la musique et avec pour seul critère d’utiliser Deezer au moins une fois par semaine, a permis d’étudier un type d’auditeur rarement considéré par la recherche sur l’écoute et la découverte de musique jusqu’à maintenant. En effet, on remarque que ce sont presque exclusivement des groupes de jeunes culturellement actifs et familiers avec la technologie qui ont été étudiés jusqu’à présent dans ce domaine : une trentaine de jeunes de 17 à 35 ans, « les plus de 25 ans étant encore pour la plupart étudiants », et « dont la consommation musicale est quotidienne et importante en termes de durée d’écoute » chez Granjon et Combes[141] ; 15 jeunes de 18 à 29 ans, dont 7 étudiants, et 10 grands amateurs (heavy listeners) contre un seul amateur occasionnel (light) chez Laplante[142] ; seulement des étudiants universitaires chez Lee et Downie[143], Cunningham[144] et Tepper et Hargittai[145]. La recherche sur les pratiques musicales ne peut pas se contenter d’étudier une minorité de jeunes mélomanes quand c’est la quasi-totalité de la population — 92 % des Français par exemple — qui écoute de la musique à un moment ou l’autre, et que c’est précisément cette majorité d’auditeurs occasionnels que les plateformes de diffusion tentent d’attirer par leurs innovations technologiques.
Cette question de la proportion d’utilisateurs « savants » par rapport à celle des « occasionnels » souligne un autre problème important. Le rapport original de l’étude de l’agence Emap sur les types d’auditeurs à l’origine de cette segmentation de la population en auditeurs « savants », « enthousiastes », « occasionnels » et « indifférents » n’est disponible nulle part. Le site Web du projet de recherche n’est plus en ligne, et il ne semble exister aucun article scientifique qui permettrait d’examiner la méthodologie employée, par exemple. Pourtant, c’est une étude qui est fréquemment citée : Julie Knibbe, chef de produit chez Deezer, la cite dans ses présentations[146] ; Oscar Celma, aujourd’hui directeur de la recherche chez Pandora, la mentionne dans son ouvrage Music Recommendation and Discovery ; Paul Lamere, directeur de la plateforme pour concepteurs chez Spotify, va jusqu’à présenter les conclusions de l’enquête comme une justification du modèle freemium qui est aujourd’hui la norme dans l’industrie musicale[147]. Un portrait complet, statistiquement représentatif et rigoureux des pratiques musicales à l’échelle nationale, en France et au Québec, est plus que jamais nécessaire, autant pour la sociologie culturelle que pour l’industrie de la musique.
Ces nouveaux efforts de recherche devront par ailleurs se réaliser en étroite collaboration avec les plateformes de diffusion en continu ainsi que les « infomédiaires » comme Echo Nest. L’écoute de musique passe désormais avant tout par l’ordinateur, et ce sont ces entreprises qui détiennent toutes les données, décident de l’organisation du catalogue musical et sélectionnent par leurs formules automatisées les titres recommandés et mis en valeur. L’étude des pratiques musicales était déjà rendue difficile par l’abandon des supports physiques comme le disque pour le numérique ; elle devient carrément impossible lorsqu’une grande partie des utilisateurs — si mes observations sont confirmées — ne prend même plus la peine d’entretenir une collection musicale, même numérique, et se contente de la boîte de recherche figurant au coin de l’interface. La « crise de la sociologie empirique » annoncée par Savage et Burrows il y a bientôt dix ans[148] est à nos portes en ce qui concerne les pratiques musicales, et une étroite collaboration avec l’industrie s’impose. Que devient le rôle du sociologue, lui qui était il n’y a pas si longtemps à l’avant-plan des recherches et de l’innovation en sciences sociales, alors que se développe sans lui l’infrastructure informationnelle omniprésente de ce que Nigel Thrift a nommé le « capitalisme de la connaissance »[149] ? On l’a vu, Echo Nest a beau recueillir une quantité impressionnante d’information sur ses utilisateurs, elle est limitée à leurs signaux implicites d’utilisation, et gagnerait beaucoup à obtenir de l’information qualitative de qualité. Quelle est la motivation qui explique ce choix de titre plutôt qu’un autre ? On peut par exemple sauter une chanson qu’on adore si elle n’est pas appropriée au contexte d’écoute ; une subtilité difficile à cerner seulement avec l’historique d’utilisation. Qu’est-ce que les utilisateurs comprennent des fonctionnalités de recommandation automatisées qui leur sont présentées ? Il serait aussi intéressant d’analyser la configuration de l’interface Deezer, de la même manière qu’Hennion l’a fait pour le magasin Virgin dans Figures de l’Amateur. Par exemple : pourquoi est-ce la fonction Flow plutôt qu’une autre qui est proposée à l’avant-plan dans l’interface ? Une collaboration éventuelle entre sociologues et ingénieurs permettrait peut-être aussi de lever le voile sur quelques aspects curieux de cette interface, en particulier le flou qui semble entretenu quant aux détails des recommandations musicales[150]. Enfin, les chercheurs ont aussi intérêt à se pencher sur les nouvelles plateformes de diffusion musicale simplement parce que c’est là que se dessine, au gré des initiatives des ingénieurs de Google, de Deezer et de Spotify[151], l’avenir d’enjeux primordiaux comme celui de la diversité culturelle. Les plateformes de diffusion en continu comme Deezer et Spotify ont le potentiel de devenir de fantastiques outils de découverte musicale, soutenant la croissance des artistes locaux et émergents. Elles pourraient tout autant finir par promouvoir une minorité d’artistes très populaires auprès de l’ensemble de leurs utilisateurs. Dans tous les cas, les sociologues et les anthropologues ont leur rôle à jouer dans le suivi de cette évolution.
Annexe 1 : Grille d’entretien ⇑
INTRODUCTION
Débuter l’enregistrement
Nom du répondant, âge. Date, Paris.
Bonjour à vous, mon nom est Louis Melançon, et j’effectue présentement un stage à Orange Labs, pour lequel je réalise la présente recherche. L’objectif du projet est d’étudier l’usage des services de streaming musical, en particulier la manière dont les utilisateurs font sens des recommandations musicales qui leur sont proposées.
S’il y a des questions auxquelles vous préférez ne pas répondre, vous êtes tout à fait libre de le faire — sans avoir à fournir de raisons et sans inconvénient.
L’audio et la retranscription de la présente rencontre ne seront disponibles qu’aux chercheurs qui participent au projet. Un pseudonyme vous sera attribué dans le rapport de recherche pour assurer la confidentialité de vos réponses.
Vous pouvez me joindre par email et téléphone pour toute question que vous pourriez avoir sur le projet.
Maintenant, commençons !
Pourriez-vous d’abord confirmer ces informations personnelles :
Votre âge, occupation, et niveau d’études
CONTEXTE D’ÉCOUTE
Fréquence d’écoute
Musique de fond vs Activité principale
Équipement
Ordinateur, smartphone, lecteur mp3, lecteur cd, tablette, chaine stéréo, cd, vinyles…
Moyen d’obtenir la musique écoutée
CD, vinyles, iTunes, BitTorrent
Sous-question : Est-ce que la qualité sonore est importante pour vous?
Montant d’argent dépensé, par mois, par année
Quel était votre plus récent achat de musique ? Sur quel support ?
Quel était votre tout premier achat de musique?
Invitation à expliquer ce qui a changé au fil du temps…
DEEZER/SPOTIFY
Quel est votre type d’abonnement?
Depuis combien de temps êtes-vous abonné au service ?
Quelle était votre motivation première à vous abonner au service Deezer ?
Écoutez-vous plus de musique qu’avant depuis que vous y êtes abonné?
Diriez-vous que Deezer / Spotify, spécifiquement, a changé la manière dont vous consommez de la musique, et si oui pourriez-vous décrire cette transformation ?
Avez-vous connecté votre service avec un réseau social comme Facebook? Pourquoi?
(Comment cela affecte-t-il la manière dont vous utilisez Deezer / Spotify ?)
Avez-vous des followers, créez-vous des playlists, écrivez-vous des commentaires pour les autres utilisateurs?
DÉCOUVERTE MUSICALE
Quels sont vos goûts musicaux?
Pourriez-vous nommer quelques-uns de vos groupes ou artistes musicaux préférés? Un artiste que vous avez découvert tout récemment?
Comment les avez-vous découverts?
Quelles sont les principales manières, en général, dont vous découvrez de la nouvelle musique? Dans quel ordre d’importance? Pourquoi? CLASSER PAR CHIFFRES
Télévision, radio, magazines, blogs, amis / collègues / réseau social, publicités, recommandations Youtube / Deezer / Spotify
Ça vous arrive de suivre les recommandations de votre application Deezer / Spotify?
En général, comment choisissez-vous ce que vous écoutez sur Deezer / Spotify? DEMANDER D’ÉCRIRE UN CHIFFRE DE 1 À 6 SUR LE QUESTIONNAIRE POUR CLASSER
Propres albums, propres playlists
Radios
Playlist recommandée
Voir ce qu’écoutent les amis
Voir ce que recommandent les « experts »
D’après la musique trouvée sur une autre plateforme (par exemple YouTube)
Pourriez-vous nous indiquer de manière approximative : 1) le nombre de playlists enregistrées 2) le nombre d’albums 3) le nombre d’artistes favoris ? 4) Quels sont les albums et les artistes que vous avez le plus écouté sur Deezer? 5) Quel est votre nombre de personnes que vous suivez; qui vous suivent?
ENTRONS MAINTENANT DANS L’INTERFACE DEEZER
Vous m’avez dit qu’un contexte d’écoute habituel pour vous était _____. Pourriez-vous me montrer ce que vous faites d’habitude à ce moment-là? QUEL ÉQUIPEMENT POUR CHAQUE CONTEXTE?
Que faites-vous habituellement en premier? Où regardez-vous? Que faites-vous par la suite?
Utilisez-vous parfois le service pour découvrir de la musique? Des exemples de découverte svp.
Quelle est la manière principale dont vous découvrez de nouvelles pièces musicales sur Deezer ? Pourquoi cette manière plutôt qu’une autre?
À votre avis et selon votre expérience personnelle avec le service, quelle est son processus pour vous recommander de nouvelles pièces musicales ? Comment Deezer détermine-t-il quelles pièces vont vous plaire ?
Êtes-vous le seul utilisateur de notre compte? Sous-question : cela vous arrive-t-il de refuser que quelqu’un utilise votre compte Deezer pour ne pas lui faire « apprendre » de mauvaises choses?
QU’EST-CE QUI FAIT QUOI
Flow : qu’est-ce que c’est? Pourquoi ça joue cela à votre avis?
Fiche de recommandation 1 : Qu’est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi cet artiste en particulier?
Fiche de recommandation 2 : ….
Onglet Explorer : Y allez-vous à l’occasion? Pourriez-vous décrire la page?
Top écoutes : Y allez-vous à l’occasion? Qu’est-ce que c’est?
Radios : Y allez-vous? Qu’est-ce que c’est?
Page d’utilisateur : Voyons voir les vrais chiffres! Êtes-vous surpris? Voir l’historique d’écoute et poser des questions.
Utilisez-vous le volet Applications?
En bas à droite : allez-vous y voir? Voir qui est connecté, ce que vos amis Facebook jouent? Les notifications d’activités de vos artistes préférés?
Êtes-vous abonné à des utilisateurs qui ne sont pas vos amis Facebook?
Travaillez-vous à obtenir des abonnements pour votre page personnelle? > Optimisation
Faites-vous attention à qui vous ajoutez comme artistes préférés, par rapport à ce que pensent vos amis, etc.?
Spotify : avez-vous déjà utilisé l’option Écoute privée?
Y a-t-il des types de recommandation culturelle auxquels vous faites confiance? Auxquels vous ne faites pas confiance?
UTILISATION SMARTPHONE (AU BESOIN)
Pourquoi écouter ou non sur smartphone?
Vous m’avez dit qu’un contexte d’écoute habituel par smartphone pour vous était _____. Pourriez-vous me montrez ce que vous faites d’habitude à ce moment-là?
Différences avec l’interface par ordinateur
Annexe 2 : Lettre d’information et formulaire de consentement ⇑
Document d’information sur le projet de recherche
Recommandation musicale et nouvelles technologies
La recherche est menée par une équipe composée de Louis Melançon, chercheur principal et étudiant de deuxième cycle en Pratiques de recherche et action publique à l’Institut national de la recherche scientifique (Montréal, Québec, 00.00.00.00.00), et Jean-Samuel Beuscart, chercheur au Laboratoire SENSE à Orange Labs (00.00.00.00.00). Cette recherche est réalisée dans le cadre du stage de maîtrise de M. Melançon et n’a pas reçu de subvention particulière.
Madame/Monsieur
Voici un ensemble d’informations sur ce projet de recherche auquel nous vous avons invité à participer. Cette participation consiste en un court entretien dans un endroit qui vous conviendra et qui sera enregistré suivant votre consentement exprès.
- L’objectif du projet est d’étudier l’usage du service Deezer/Spotify, en particulier la manière dont les utilisateurs font sens des recommandations musicales qui leur sont proposées. La recherche permettra d’éclairer ce nouveau type de consommation culturelle par ordinateur et téléphone mobile, encore très peu étudié.
- Votre participation au projet consistera à accorder une entrevue d’environ une heure à Louis Melançon. Cette entrevue portera sur divers aspects de votre utilisation du service Deezer/Spotify. Les données seront utilisées par l’équipe de recherche afin de mieux comprendre la manière dont les diverses formules de recommandation du service sont comprises et utilisées par ses usagers.
- En participant à cette recherche, vous contribuerez à une meilleure compréhension des nouvelles pratiques de consommation culturelle en France. Les données recueillies seront utiles à l’avancement des connaissances portant sur l’impact des nouvelles technologies de l’information, plus précisément sur les formules de recommandation musicale. Par ailleurs, l’entrevue ne comporte pas de risque connu puisque la confidentialité des entrevues est assurée — seul le risque d’une identification indirecte pouvant dès lors subsister.
- S’il y a des questions auxquelles vous ne pouvez ou préférez ne pas répondre, vous êtes tout à fait libre de choisir de ne pas le faire — sans avoir à fournir de raisons et sans inconvénient. Sachez par ailleurs qu’à titre de participant volontaire à cette étude, vous avez la possibilité de vous en retirer à tout moment si vous le jugez nécessaire.
- La confidentialité des résultats sera assurée de la façon suivante: un pseudonyme alphanumérique vous sera attribué pour assurer la confidentialité des entrevues (a1, a2, b1, b2, etc.).
Une fois retranscrites, les entrevues seront conservées dans des fichiers sécurisés par mot de passe. Les retranscriptions ne seront accessibles qu’aux chercheurs qui participent au projet. Les fichiers audio seront détruits un an après la fin de la recherche (2015) ; les retranscriptions anonymisées, quant à elles, seront conservées pour une période de trois ans (2017). Les données recueillies ne serviront que dans le cadre de la présente recherche.
Vous trouverez ci-joints deux exemplaires d’un formulaire de consentement que nous vous demandons de signer si vous acceptez de nous accorder l’entrevue. L’objectif de ce formulaire est de démontrer que les responsables de la recherche ont le souci de protéger le droit des personnes qui y participent. Avant de signer le formulaire, vous pouvez, si vous le désirez, demander au chercheur toutes les informations supplémentaires que vous jugerez à propos d’obtenir sur le projet de recherche. Vous pouvez aussi rejoindre un des membres de l’équipe pour des informations supplémentaires dont les coordonnées apparaissent sur cette lettre. Vous trouverez également à la fin de cette lettre le nom d’une personne extérieure à la recherche susceptible de vous renseigner sur vos droits en tant que sujet de cette recherche, Mme Cathy Vaillancourt.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Chercheur principal
Louis Melançon
Personne ressource à l’intérieur de l’équipe de recherche :
Jean-Samuel Beuscart
Personne ressource extérieure à l’équipe de recherche :
Madame Cathy Vaillancourt
Présidente du Comité d’éthique en recherche avec des êtres humains
Superviseur extérieur à l’équipe de recherche :
Jonathan Roberge
Formulaire de consentement des personnes interviewées
Recommandation musicale et nouvelles technologies
J’ai pris connaissance du projet de recherche décrit dans la lettre d’information.
J’ai été informé(e), oralement et par écrit, des objectifs du projet, de ses méthodes de cueillette des données et des modalités de ma participation au projet.
J’ai également été informé(e) :
- de la façon selon laquelle les chercheurs assureront la confidentialité des données et en protégeront les renseignements recueillis,
- de mon droit de mettre fin à l’entrevue ou à son enregistrement, si je le désire, ou de ne pas répondre à certaines questions,
- de mon droit, à titre de participant volontaire à cette étude, de m’en retirer sans préjudice à tout moment si je le juge nécessaire.
- de mon droit de communiquer, si j’ai des questions, avec le chercheur principal du projet (Louis Melançon).
J’ai l’assurance que les propos recueillis au cours de cet entretien seront traités de façon confidentielle et anonyme. Cependant, je suis conscient que malgré toutes les précautions prises à cet effet, il demeure possible que je sois identifié de manière indirecte.
J’accepte, par la présente, de participer à la recherche selon les modalités décrites dans la lettre d’information sur le projet, ci-annexée.
Je signe ce formulaire en deux exemplaires et j’en conserve une copie.
Signature du participant Date
Approbation du Comité d’éthique en recherche avec des êtres humains de l’INRS : 5 sept. 2014
Notes de bas de page ⇑
[1] Comme l’a noté le professeur Claude Martin dans un article du Devoir, la situation doit vraiment être mauvaise pour que Québecor, qui possédait jusque-là des entreprises à toutes les étapes de la production musicale, renonce ainsi à son intégration verticale parfaite du marché. Voir l’article http://www.ledevoir.com/culture/musique/440815/vente-d-archambault-les-intentions-musicales-de-m-renaud
[2] http://www.cnet.com/news/apples-plan-to-wipe-out-disc-drives-is-nearly-complete/
[3] Selon l’agence Nielsen, on enregistre la première baisse de téléchargements au Canada en 2014. Voir http://www.nielsen.com/ca/en/press-room/2015/2014-nielsen-music-canada-report.html
[4] Toujours selon Nielsen, le nombre de titres musicaux (audios et vidéos) joués en diffusion continue aux États-Unis a augmenté de 55 % entre 2013 et 2014. Au Canada, où ces chiffres sont comptabilisés seulement depuis juillet 2014, on a observé une hausse de 67 % entre les six derniers mois de 2014 et les six premiers mois de 2015. Voir http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/2014-nielsen-music-report.html et http://www.nielsen.com/ca/en/press-room/2015/2015-nielsen-mid-year-music-canada-report.html
[5] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/pratiques-culturelles/incidence-numerique-pratiques.pdf
[6] Le rapport Infinite Dial 2015 de Edison Research indique que c’est maintenant 63 % de la population américaine âgée de 12 ans et plus, dont 90 % de la population entre 12 et 24 ans, qui dit avoir déjà écouté de la musique sur YouTube. Voir http://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2015/
[7] Hennion, A., Maisonneuve, S., & Gomart, E. (2000). Figures de l’amateur : formes, objets, pratiques de l’amour de la musique aujourd’hui. La documentation française, p.126-127.
[8] Granjon, F., & Combes, C. (2007). La numérimorphose des pratiques de consommation musicale. Réseaux (n° 145-146), p. 294-295. LIEN
[9] Du latin nubes « nuage », en référence à l’infonuagique (le cloud) qui rend possibles ces nouveaux services de diffusion musicale.
[10] Ma traduction. https://www.apple.com/pr/library/2001/02/22Apple-Unveils-New-iMacs-With-CD-RW-Drives-iTunes-Software.html
[11] http://apple-history.com/2400
[12] Smoreda, Z., Beauvisage, T., de Bailliencourt, T., & Granjon, F. (2007). Entrelacement des pratiques de communication et de loisir. Réseaux (n° 145-146). LIEN
[13] Granjon et Combes 2007, p. 293.
[14] Ibid.
[15] Poirier, C. et coll. (2012). La participation culturelle des jeunes à Montréal — Des jeunes culturellement actifs. Montréal, INRS-UCS, 2012, p. 56. LIEN
[16] Hennion et coll. 2000, p. 77.
[17] Ibid., p. 81.
[18] Ibid., p. 79.
[19] Ibid., p.87.
[20] Ibid., p. 103.
[21] Ibid., p. 113-115.
[22] Ibid., p. 116.
[23] Ibid., p. 126.
[24] Ibid., p. 131-132.
[25] Ibid., p. 142.
[26] Granjon et Combes 2007, p. 295.
[27] Smoreda, Z., Beauvisage, T., de Bailliencourt, T., & Granjon, F. (2007). Entrelacement des pratiques de communication et de loisir. Réseaux (n° 145-146). LIEN
[28] Granjon et Combes 2007, p. 295.
[29] Ibid., p. 300.
[30] Ibid., p. 301.
[31] Ibid., p. 302-303.
[32] Ibid., p. 304.
[33] Ibid., p. 309.
[34] Ibid., p. 314.
[35] Ibid., p. 315.
[36] Ibid., p. 317.
[37] Ibid., p. 321.
[38] Ibid., p. 322.
[39] Ibid., p. 324-325.
[40] Ibid., p. 327.
[41] Ibid., p. 329.
[42] Laplante, A. (2008). Everyday life music information-seeking behaviour of young adults: an exploratory study. McGill University. p. 115. LIEN
[43] Ibid., p. 124-127.
[44] Ibid., p. 135.
[45] Ibid., p. 213.
[46] Ibid., p. 218.
[47] Ibid., p. 247-249.
[48] Voir Laplante, A. (2011). Social Capital and Music Discovery: An Examination of the Ties through Which Late Adolescents Discover New Music. ISMIR (pp. 341-346) LIEN et Laplante, A. (2012). Who influence the music tastes of adolescents? : a study on interpersonal influence in social networks. Proceedings of the second international ACM workshop on Music information retrieval (pp. 37-42). LIEN
[49] Cet usage n’est pas prévu par YouTube, mais il est facile de créer des fichiers MP3 à partir de vidéos musicaux, en installant une extension sur son navigateur Web par exemple.
[50] Poirier et coll. 2012, p. 127. La plateforme la plus populaire et la plus mentionnée chez les jeunes, « de loin », est évidemment Facebook : tous les jeunes rencontrés ou presque y possèdent un compte.
[51] Participante B4, une jeune fille de 16 ans. Poirier et coll. 2012, p. 406.
[52] Donnat, O. (2008). Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, Paris, La Découverte/Ministère de la Culture et de la Communication, p. 13.
[53] Donnat 2008, p. 24.
[54] Ibid., p. 15.
[55] Ibid., p. 206.
[56] Donnat, O. (2009) Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : Éléments de synthèse 1997-2008. Culture études 5/2009 (n° 5), p. 11. LIEN
[57] Donnat 2008, p. 127.
[58] Ibid., p. 128.
[59] Ibid.
[60] Granjon et Combes 2007, p. 294.
[61] Voir http://www.cefrio.qc.ca/publications/internet-medias-sociaux-mobilite/netendances-2012-divertissement/ et http://www.cefrio.qc.ca/netendances/televiseur-branche-incontournable/
[62] Les résultats sont « pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la région et de la langue des répondants, afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des adultes québécois ». La marge d’erreur est d’environ 3 %, 19 fois sur 20 (enquêtes 2012 et 2014, p. 3).
[63] Nielsen U.S. Music year-end report 2014.
[64] Chiffres datant d’avril 2014 http://thenextWeb.com/mobile/2014/04/10/milk-music-now-underway-us-samsung-taps-deezer-tempt-music-fans-europe/
[65] https://www.deezer.com/offers/
[66] L’interface ici décrite et affichée est celle datant d’octobre 2014. Elle a été légèrement modifiée depuis (en témoigne le bouton « Tester le nouveau Deezer » affiché en haut de la page).
[67] Comme pour toutes les formules automatisées de recommandation sur Deezer (et Spotify), les détails précis de la formule du Flow ne sont pas dévoilés. On décrit la fonctionnalité en des termes généraux comme « une sélection de titres à votre image » et « il s’adapte à vos goûts », mais sans plus de précisions. Le code informatique derrière la formule, un secret commercial, n’est pas accessible. Voir https://www.deezer.com/features
[68] https://news.spotify.com/us/2015/06/10/20-million-reasons-to-say-thanks/
[69] YouTube demeure le diffuseur de musique le plus important, mais fonctionne différemment.
[70] Pour les détails techniques, voir l’article du fondateur et scientifique en chef de Shazam : Wang, A. (2003). An Industrial Strength Audio Search Algorithm. ISMIR (pp. 7-13). LIEN
[71] Celma, O. (2010). Music Recommendation and Discovery. Springer Berlin Heidelberg.
Fait intéressant, l’auteur est devenu en 2014 directeur de la recherche chez Pandora, un service de diffusion musicale regroupant près de 80 millions d’utilisateurs actifs, offert seulement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
[72] D’après le Nielsen US Music Report 2007. Voir Celma 2010, p. 4.
[73] … ou devrais-je dire, de Let It Go.
[74] Selon Jérémie Mary de l’Université de Lille, ayant contribué à l’élaboration de la formule de recommandation Deezer https://www.inria.fr/centre/lille/actualites/deezer-a-votre-ecoute
[75] http://blog.deezer.com/fr/deezer-devient-votre-deezer/
[76] http://blog.deezer.com/fr/deezer-libere-votre-musique-sur-les-mobiles-le-Web-et-vos-tablettes/
[77] Celma 2010, p. 5.
[78] Voir Celma 2010, p. 7.
[79] Voir le chapitre 2 de l’ouvrage de Celma, p. 15-42, pour plus de détails.
[80] Celma 2010, p. 36.
[81] Voir Herlocker, J. L., Konstan, J. A., & Riedl, J. (2000). Explaining collaborative filtering recommendations. Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 241-250). ACM. LIEN
[82] http://the.echonest.com/company/
[83] Morris, J. W. (2015). Curation by code: Infomediaries and the data mining of taste. European Journal of Cultural Studies, 18 (4-5), p. 453. LIEN
[84] Morris 2015, p. 452.
[85] Ibid., p. 455.
[86] https://insights.spotify.com/us/about-spotify-insights/
[87] https://labs.spotify.com/about/
[88] http://notes.variogr.am/post/37675885491/how-music-recommendation-works-and-doesnt-work
[89] Toujours d’après l’article de Whitman.
[90] Selon Alexandre Croiseaux de chez Deezer http://www.liberation.fr/ecrans/2014/11/27/spotify-et-deezer-l-algorithme-dans-la-peau_1152112
[91] Pour une liste plus complète des applications développées sur l’infrastructure Echo Nest, voir la page http://the.echonest.com/showcase/
[92] http://notes.variogr.am/post/125515460365/fresh-finds
[93] https://insights.spotify.com/us/2015/07/13/musical-map-of-the-world/
[94] http://everynoise.com/engenremap.html; voir aussi http://blog.echonest.com/post/52385283599/how-we-understand-music-genres
[95] http://static.echonest.com/SpotifyPopcorn/
[96] http://musicmachinery.com/2014/09/08/more-on-wheres-the-drama/
[97] http://musicmachinery.com/2015/06/16/the-drop-machine/
[98] http://skynetandebert.com/2015/04/22/music-was-better-back-then-when-do-we-stop-keeping-up-with-popular-music/
[99] Les entretiens étant menés en personne, au domicile des répondants, ce critère a été choisi pour limiter les déplacements à un maximum d’une heure de transport à partir du centre de Paris.
[100] Certains participants ont indiqué vouloir participer à une seconde étude, mais n’ont pas spécifié leur adresse ou leur numéro de téléphone par la suite, ce qui fait en sorte qu’il était impossible de les contacter (la réticence des internautes à divulguer leurs informations personnelles était justement une des conclusions de l’enquête).
[101] Il y a eu un malentendu avec notre répondant Nicolas. Une fois rendu chez lui (à une heure de Paris), il m’a appris qu’il n’utilisait ni Deezer ni Spotify, ce qui était pourtant confirmé au préalable par téléphone. J’ai quand même mené l’entretien, m’intéressant à son utilisation du service YouTube.
[102] Sauf dans un cas, celui de Stéphane, où l’entretien a eu lieu dans mon bureau chez Orange, et sur mon ordinateur.
[103] Voir le questionnaire complet en Annexe 1.
[104] Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. Psychol. Bull., 51, 4, 327-358. LIEN
[105] L’application de cette méthode pour la formulation des questions a été spontanée : j’ai découvert l’article de Flanagan seulement après avoir mené les entretiens.
[106] J’ai utilisé la version Lite du logiciel, gratuite http://provalisresearch.com/fr/produits/logiciel-d-analyse-qualitative/logiciel-gratuit/
[107] Voir Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford university press, p. 401 et p. 569.
[108] Énoncé de politique des trois Conseils (2014). Éthique de la recherche avec des êtres humains. Ottawa, ON : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada. LIEN
[109] Voir en Annexe 2.
[110] Cette application, il va sans dire, n’est pas officielle, et ce genre d’utilisation de Deezer n’est pas prévu par la compagnie, surtout pour un compte gratuit comme celui de Julie.
[111] En français québécois : dans un magasin d’articles de rénovation.
[112] Certains titres peuvent en effet devenir inaccessibles sur Deezer en raison d’une nouvelle entente avec une maison d’édition ou un artiste, par exemple.
[113] Radio musicale du groupe Radio France à la programmation éclectique, et sans aucune publicité. LIEN
[114] Tel qu’il a déjà été mentionné, il y a eu malentendu avec Nicolas. En effet, il n’utilise ni Deezer, ni Spotify. Son entretien a donc porté sur YouTube.
[115] Les albums de Led Zeppelin sont maintenant disponibles sur Deezer, depuis février 2015.
[116] Julien s’est plaint que certains de ses titres enregistrés n’étaient soudainement plus accessibles.
[117] Cette confusion devait être généralisée, parce que cette fonctionnalité a été renommée Mix depuis, et a disparu de la liste des onglets. On y accède maintenant à partir d’un bouton sur la page de profil des artistes.
[118] Laplante 2008, p. 60-62.
[119] Cunningham, S. J., Reeves, N., & Britland, M. (2003). An ethnographic study of music information seeking: implications for the design of a music digital library. Proceedings of the third ACM/IEEE‐CS joint conference on Digital libraries (5 ‐ 16).
[120] Lee, J. H., & Downie, J. S. (2004). Survey of music information needs, uses, and seeking behaviours: preliminary findings. 5th International Conference on Music Information Retrieval, Barcelona, Spain.
[121] Taheri‐Panah, S., & MacFarlane, A. (2004). Music Information Retrieval systems: Why do individuals use them and what are their needs? In C. L. Buyoli & R. Loureiro (Eds.), ISMIR 2004: Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval (pp. 455‐ 459).
[122] Cunningham, S. J., Jones, M., & Jones, S. (2004). Organizing digital music for use: an examination of personal music collections. In C. L. Buyoli & R. Loureiro (Eds.), ISMIR 2004: Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval (pp. 447‐ 454).
[123] Hennion et coll. 2000, p.116-117.
[124] Ma traduction. Morris 2015, p. 452.
[125] Ma traduction. Ibid.
[126] Ma traduction. Ibid., p. 453.
[127] Hennion et coll. 2000, p. 132-133.
[128] Granjon et Combes 2007, p. 328.
[129] Morris 2015, p. 460.
[130] Granjon et Combes 2007, p. 301.
[131] Ibid.
[132] http://www.zdnet.fr/actualites/axel-dauchez-deezer-le-cap-du-million-d-abonnes-payants-sera-passe-cet-ete-39758891.htm
[133] Hennion et coll. 2000, p. 142.
[134] Granjon et Combes 2007, p. 301.
[135] Donnat 2008, p. 206.
[136] On se rappelle aussi la participante B4 de l’enquête de Poirier au Québec citée précédemment, qui affirme à 16 ans découvrir la musique non pas grâce à ses amis, mais à travers les recommandations YouTube.
[137] http://musicmachinery.com/2014/01/14/the-zero-button-music-player-2/
[138] Voir le résumé de David Jennings http://alchemi.co.uk/archives/mus/groups_and_beha.html
[139] Voir http://www.wired.com/2015/08/cant-squat-spotifys-eerie-new-privacy-policy/
[140] https://news.spotify.com/us/2015/08/21/sorry-2/
[141] Granjon et Combes 2007, p. 293.
[142] Laplante 2008, p. 98-99.
[143] Lee et Downie 2004.
[144] Cunningham et coll. 2007.
[145] Tepper et Hargittai 2009.
[146] http://fr.slideshare.net/julieknibbe/deezer-big-data-as-a-streaming-service
[147] http://musicmachinery.com/2014/01/14/the-zero-button-music-player-2/
[148] Savage, M., & Burrows, R. (2007). The coming crisis of empirical sociology. Sociology, 41 (5), 885-899.
[149] Thrift, N. (2005). Knowing capitalism. Sage.
[150]« Les explications justifiant les recommandations sont aussi importantes que la liste d’éléments recommandés elle-même » (Celma 2010, op. cit.). Voir la section La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique de ce rapport, en particulier les notes 80 et 81.
[151] Il sera extrêmement intéressant de lire à ce sujet le prochain livre de l’anthropologue Nick Seaver, une recherche ethnographique auprès des ingénieurs du service musical Pandora.
